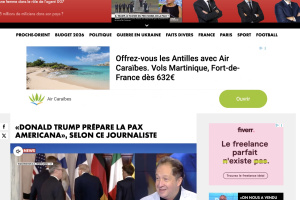La question dérange parce qu’elle oblige à regarder au-delà des slogans, des discours calibrés et des images soigneusement construites. Elle dérange parce qu’elle ne met pas en cause une intention proclamée, mais des résultats politiques concrets. Elle dérange enfin parce qu’elle touche au cœur d’une contradiction qui traverse l’Arabie saoudite depuis plus d’un demi-siècle et qui, aujourd’hui, ressurgit brutalement à travers la guerre du Yémen et la recomposition idéologique du Royaume. Poser la question de savoir si Mohammed ben Salmane est tombé dans le piège des Frères musulmans, ce n’est pas l’accuser d’adhésion doctrinale, mais interroger une continuité historique que le vernis de la modernisation peine à effacer.
Pour comprendre, il faut remonter à l’origine, à un moment où l’Arabie saoudite, encore en construction, a fait un choix stratégique majeur. Dans les années 1950 et 1960, alors que le monde arabe est traversé par le nationalisme laïc, le socialisme arabe et le nassérisme, le Royaume se positionne comme un pôle de résistance idéologique. C’est à ce moment que des cadres des Frères musulmans, pourchassés en Égypte et ailleurs, trouvent refuge en Arabie saoudite. Ils n’y arrivent pas comme un parti organisé, mais comme enseignants, intellectuels, prédicateurs. Ils investissent l’éducation, la formation religieuse, la prédication sociale. L’État saoudien y voit alors un outil utile. Ces hommes apportent une capacité d’organisation, une méthodologie militante, une vision du monde structurée, capable de contrer ses ennemis idéologiques de l’époque.
De cette rencontre naît une hybridation qui marquera durablement le paysage religieux et politique du Royaume. Le salafisme local, rigoriste sur le plan doctrinal mais historiquement peu porté vers l’organisation politique moderne, se combine avec la culture frériste du réseau, de la mobilisation et du travail de terrain. C’est cette synthèse qui donnera naissance à ce que l’on appellera plus tard la Sahwa, le “réveil islamique”. Pendant des décennies, ce courant va prospérer, souvent avec la bienveillance implicite du pouvoir, parfois avec son soutien direct, notamment lorsqu’il s’agit d’exporter une influence religieuse et idéologique à l’étranger.
Ce point est essentiel pour comprendre l’ampleur du paradoxe actuel. L’Arabie saoudite n’a pas seulement accueilli l’islam politique, elle a contribué à sa diffusion mondiale. À travers des institutions religieuses, des organisations caritatives, des réseaux éducatifs, elle a financé des mosquées, des centres islamiques, des programmes de formation en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe. Tout n’était pas frériste, loin de là, mais le cadre idéologique général, conservateur, identitaire et souvent hostile à la sécularisation, a offert un terreau favorable aux courants islamo-politiques. Cette réalité historique ne peut être effacée par un simple changement de discours.
Lorsque Mohammed ben Salmane arrive au premier plan, il hérite de cet héritage lourd. Il hérite d’un champ religieux fragmenté, traversé par des courants concurrents, dont certains ont développé une capacité d’influence sociale autonome. Sa réponse est brutale, rapide, centralisatrice. Il s’attaque à la Sahwa, marginalise ses figures, redéfinit le rôle du religieux dans l’espace public. Il proclame la fin de l’islam politique, rejette les idéologies transnationales, affirme vouloir ramener l’islam à une dimension nationale, culturelle, encadrée par l’État. En parallèle, il lance un projet de transformation économique et sociale ambitieux, incarné par Vision 2030, destiné autant à préparer l’après-pétrole qu’à reconstruire l’image du Royaume auprès de l’Occident.
Mais c’est précisément là que la fracture apparaît entre le discours et certaines pratiques, notamment sur le plan régional. La guerre du Yémen en est l’illustration la plus frappante. En 2015, l’intervention saoudienne est présentée comme une nécessité stratégique face à l’expansion iranienne et à la prise de pouvoir des Houthis. L’objectif affiché est la restauration de la légitimité de l’État yéménite. Or cette légitimité n’est pas neutre. Elle repose sur un assemblage hétéroclite de forces politiques et militaires, parmi lesquelles figure un acteur central, le parti Al-Islah, branche yéménite des Frères musulmans.
Ce choix n’est pas idéologique, il est opérationnel. Dans un État effondré, sans institutions solides, les forces les mieux organisées, les plus enracinées socialement et capables de mobiliser rapidement des combattants deviennent des partenaires incontournables. Al-Islah coche toutes ces cases. Le résultat est implacable. Sous couvert de défendre la légitimité internationale, la guerre confère à ce parti une reconnaissance politique et un espace d’action qu’il n’aurait jamais obtenus autrement. Dans le Sud du Yémen, cette réalité est vécue comme une trahison. Les populations sudistes, historiquement hostiles aux Frères musulmans et à toute domination islamo-politique, perçoivent l’intervention saoudienne non comme une libération, mais comme une reconduction d’une hégémonie idéologique qu’elles rejettent.
C’est ici que la notion de “piège” prend tout son sens, non pas comme un complot savamment orchestré par les Frères musulmans, mais comme un enchaînement de décisions qui produisent des effets contraires aux objectifs proclamés. En voulant contenir l’Iran, l’Arabie saoudite renforce indirectement un courant islamiste sunnite. En prétendant combattre l’islam politique, elle se retrouve à composer avec lui sur un théâtre de guerre majeur. Cette contradiction nourrit le doute, fragilise le discours officiel et alimente l’idée que le changement serait plus cosmétique que structurel.
Certains avancent que Mohammed ben Salmane ne ferait que “jouer un rôle” pour séduire l’Occident, que son rejet de la salafisation et de l’islam politique ne serait qu’un habillage destiné à sécuriser les investissements et la coopération internationale. Cette lecture est trop simpliste. Les transformations internes sont réelles, profondes, parfois irréversibles. Mais elles ne signifient pas une rupture totale avec les logiques anciennes. L’État saoudien reste fidèle à un principe fondamental qui traverse toute son histoire moderne : contrôler le religieux, l’utiliser quand il sert la stabilité du pouvoir, le réprimer quand il devient autonome ou concurrent.
La question de la mouvance dite “madkhaliste” s’inscrit dans cette continuité. Contrairement à certaines accusations, Mohammed ben Salmane n’a pas inventé ce courant. Il s’est développé bien avant lui, dans les années 1990, comme une réponse doctrinale à la contestation de la Sahwa, en mettant l’accent sur l’obéissance au pouvoir et le rejet de toute action politique organisée. Là encore, il ne s’agit pas de promouvoir un islam politique alternatif, mais de neutraliser toute capacité de mobilisation indépendante. Le problème n’est donc pas la cohérence idéologique, mais la cohérence politique d’ensemble.
Au terme de cette analyse, une conclusion s’impose. Mohammed ben Salmane n’est pas tombé dans le piège des Frères musulmans par naïveté ou par conviction. Il est prisonnier d’une histoire qu’il tente de réécrire sans pouvoir en effacer toutes les traces. La guerre du Yémen révèle cette tension de manière crue. Elle montre qu’un État peut vouloir rompre avec l’islam politique tout en en subissant encore les effets, voire en les reproduisant malgré lui, lorsque les réalités géopolitiques l’y contraignent.
La véritable question n’est donc pas de savoir si Mohammed ben Salmane dit la vérité lorsqu’il affirme combattre l’islam politique, mais de savoir si un pouvoir qui a longtemps nourri, instrumentalisé et exporté ces idéologies peut réellement s’en affranchir sans accepter des contradictions majeures et des coûts stratégiques considérables. Le Yémen, aujourd’hui encore, semble apporter une réponse implacable.
Lahcen Isaac Hammouch est journaliste et écrivain belgo marocain. Auteur de plusieurs ouvrages et tribunes, il s’intéresse aux enjeux de société, à la gouvernance et aux transformations du monde contemporain.