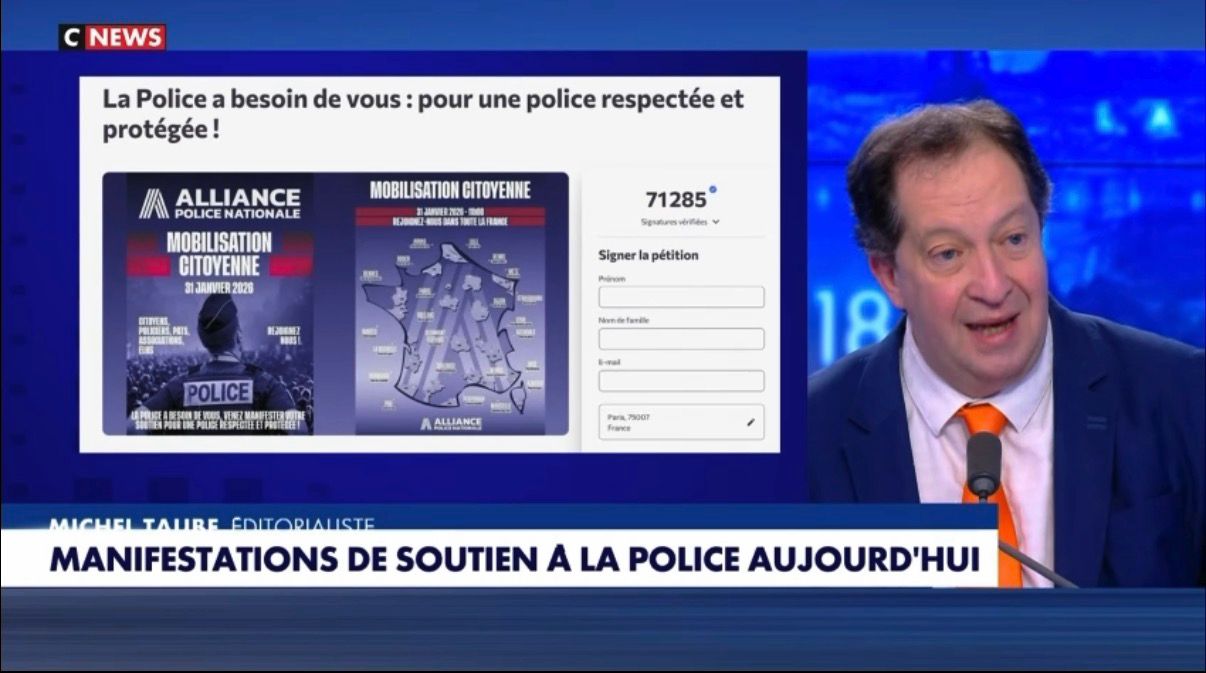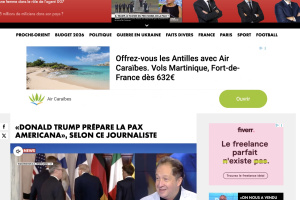Il y a des décorations qui honorent celui qui les reçoit. Et il y en a, plus rares, qui honorent la République elle-même. En remettant à Ali Akbar les insignes de chevalier de l’Ordre national du Mérite, Emmanuel Macron n’a pas seulement distingué un homme. Il a, peut-être sans le dire pleinement, rendu hommage à une France qui disparaît, à un Paris qui s’efface, à une manière d’habiter l’espace public que notre époque numérique, silencieuse et pressée, a presque fait disparaître.
Car Ali Akbar n’est pas un simple vendeur de journaux. Il est une mémoire ambulante. Une silhouette. Une voix. Une respiration. Depuis plus de cinquante ans, il n’a pas vendu du papier, il a porté la presse à bout de bras, littéralement. Il l’a incarnée. Il l’a criée. Il l’a rendue audible dans un monde où l’information est devenue muette, lue en silence sur des écrans que l’on scrolle distraitement dans le métro.
Dans les rues de Saint-Germain-des-Prés, entre Sciences Po, le Café de Flore et la brasserie Lipp, Ali Akbar était un repère. Un repère sonore dans une capitale qui s’est peu à peu tue. Là où autrefois des dizaines de crieurs annonçaient les nouvelles du jour, il est resté le dernier. Non par nostalgie, mais par fidélité à un métier qui, pour lui, n’était pas un gagne-pain, mais une manière d’exister parmi les autres, de parler aux autres, de vivre avec les autres.
Son histoire personnelle, venue du Pakistan, passée par la pauvreté, la violence, l’exil, la plonge à Rouen, puis le hasard d’une rencontre avec le professeur Choron, pourrait à elle seule remplir un roman. Mais ce qui frappe n’est pas seulement le parcours. C’est l’attachement. L’attachement viscéral à la France, à Paris, à la langue française, qu’il manie avec une irrévérence délicieuse, une créativité joyeuse, une liberté d’esprit qui ferait pâlir bien des éditorialistes trop sérieux.
Ali Akbar est devenu, au fil des décennies, plus qu’un vendeur de journaux. Il est devenu un personnage parisien, au sens noble du terme. Un de ces visages qui font qu’une ville n’est pas qu’un décor, mais une âme. Un de ces hommes qui donnent chair à la vie publique sans jamais occuper une fonction officielle. Une figure populaire, au sens le plus pur, c’est-à-dire aimée sans avoir jamais rien revendiqué.
Dans une époque où l’on parle d’intégration comme d’un problème administratif, Ali Akbar en est la démonstration vivante, silencieuse, évidente. Il n’a jamais théorisé son amour pour la France. Il l’a vécu, jour après jour, en criant les titres de ses journaux, en plaisantant avec ses clients, en devenant, par sa seule présence, « l’accent du VIe arrondissement », comme l’a joliment dit le chef de l’État.
Cette décoration dit aussi quelque chose de notre rapport à la presse. Elle rappelle que le journal n’est pas qu’un contenu, un flux, une notification. Il est un objet, un lien social, une rencontre. Il se vendait à la criée. Il s’achetait avec un sourire. Il s’accompagnait d’un échange. Ali Akbar nous rappelle que l’information fut un jour une scène vivante, une parole partagée, un théâtre de rue.
À 73 ans, avec une retraite modeste, il continue de travailler. Non par nécessité seulement, mais par fidélité à cette vie qu’il s’est construite. « La retraite, ce sera au cimetière », dit-il en riant. Et l’on comprend que pour lui, arrêter serait disparaître.
En décorant Ali Akbar, la République a, peut-être sans le savoir, salué l’un de ses plus beaux visages. Celui d’un homme venu d’ailleurs, devenu plus parisien que bien des Parisiens, et qui, pendant un demi-siècle, a rappelé à tous que la presse n’était pas seulement écrite, mais criée, vécue, partagée.
Ali Akbar n’est pas le dernier crieur de journaux. Il est le dernier témoin d’une France où la rue parlait encore.