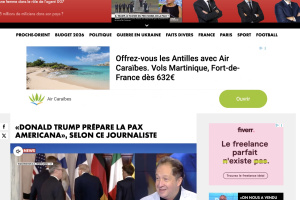Le Maroc est à un tournant. À mesure que s’approfondit la crise sociale et morale du pays, la fracture entre la volonté royale et la pratique gouvernementale devient flagrante. D’un côté, un souverain qui réaffirme, discours après discours, la nécessité d’un État social, d’une gouvernance éthique, d’une économie équitable et d’une justice indépendante. De l’autre, un gouvernement qui peine à traduire cette orientation dans les faits — et qui, par son inertie et ses conflits d’intérêts, sabote l’esprit même des réformes.
Le contraste n’a jamais été aussi visible. Les Marocains ont salué les décisions du dernier Conseil des ministres : hausse des budgets de la santé et de l’éducation, encouragement de la jeunesse à la participation politique, soutien aux petites entreprises. Mais à peine ces mesures annoncées, une question s’impose : qui, concrètement, les mettra en œuvre ? Car si la monarchie fixe la vision, le gouvernement, lui, reste le maillon faible. Et c’est là que le Maroc se perd.
Depuis son arrivée à la tête du gouvernement, Aziz Akhannouch concentre sur sa personne un symbole de ce dysfonctionnement : celui d’un pouvoir politique absorbé par les logiques du marché. Le Premier ministre, chef d’un empire économique qui domine plusieurs secteurs stratégiques — énergie, agroalimentaire, distribution —, incarne la confusion entre l’État et le patronat. Son parti, le Rassemblement national des indépendants (RNI), s’est construit autour de réseaux d’affaires, de clientélisme et de notables locaux liés aux milieux économiques. Il fonctionne comme une structure hybride : ni parti politique au sens classique, ni force d’alternance, mais plutôt un prolongement du secteur privé dans la sphère publique.
C’est ce modèle qui paralyse aujourd’hui la réforme de la gouvernance. Sous le vernis des grandes annonces, le système tourne à vide. Le gouvernement parle de moralisation, mais il a retiré le projet de loi sur l’enrichissement illicite, pourtant central dans la lutte contre la corruption. Il invoque la transparence, mais bloque la création d’une commission parlementaire sur le scandale de la “Faraqchria”, qui a vu des entreprises proches du pouvoir bénéficier d’aides publiques sans bénéfice pour le consommateur. Il prétend défendre la concurrence, mais maintient des monopoles qui étranglent les petites entreprises et faussent les règles du marché.
La situation devient d’autant plus alarmante que cette logique de prédation s’étend à la gestion des politiques publiques. Des marchés attribués sans appel d’offres, des nominations basées sur la loyauté partisane, des budgets dévoyés… Les exemples se multiplient. Le secteur de la santé, censé être la priorité absolue du mandat, illustre cette dérive. Trois ans après l’annonce d’une “réforme globale”, la réalité est crue : infrastructures vétustes, manque de personnel, centralisation excessive des décisions et une opacité totale sur la gestion des fonds. L’État social que la monarchie appelle de ses vœux devient un slogan vidé de sens.
Cette déconnexion entre le discours et la réalité nourrit une colère sourde. Dans la rue comme sur les réseaux, la génération montante, souvent désignée comme la “Génération Z 212”, exprime un rejet massif de la classe politique. Ce n’est pas un rejet du système institutionnel, mais de ceux qui en abusent. Ces jeunes, instruits, connectés, maîtrisant les codes du monde moderne, ne croient plus aux formules creuses ni aux discours de façade. Ils voient, en temps réel, les contradictions d’un pouvoir qui parle de justice sociale tout en protégeant les fortunes établies.
Le Maroc de 2025 n’est plus celui de 2011. À l’époque, face à la vague du “Printemps arabe”, le pays avait trouvé une issue intelligente et pacifique. Le discours royal du 9 mars avait ouvert un horizon de réformes, consacré la reconnaissance des libertés publiques et redéfini la place du citoyen dans la vie politique. Le Maroc avait échappé à la tempête grâce à une réactivité politique exemplaire. Mais quatorze ans plus tard, l’équilibre s’effrite. Le danger ne vient plus d’une contestation idéologique, mais d’une fracture morale. Le peuple ne se rebelle pas, il se détache. Il ne crie pas dans la rue, il se tait — et s’en va.
Le désespoir est silencieux mais massif. La jeunesse s’exile, les cadres quittent le pays, les classes moyennes s’appauvrissent, et l’économie informelle devient le seul refuge pour des millions de citoyens. Pendant ce temps, le gouvernement parle de “résilience”, alors qu’il entretient une économie duale : un secteur moderne tourné vers les élites et un secteur précaire pour le reste du pays.
Ce double discours est insupportable. Comment invoquer la “bonne gouvernance” quand les institutions de régulation — Conseil de la concurrence, Cour des comptes, Instance anticorruption — sont affaiblies ou contournées ? Comment parler de transparence quand des journalistes et des lanceurs d’alerte sont poursuivis pour avoir dénoncé la corruption ? Comment prétendre défendre le citoyen quand les décisions économiques favorisent toujours les mêmes groupes, souvent liés au pouvoir ?
Le gouvernement Akhannouch, par son inertie, alimente la défiance et met en péril l’unité du projet national. Car derrière la communication officielle, c’est une réalité brutale qui se cache : celle d’un État fragmenté, où l’intérêt général cède la place aux intérêts privés. Cette dérive n’est pas seulement une faute politique, c’est une menace pour la stabilité sociale.
Pourtant, les signaux venus du sommet sont clairs. Le roi a rappelé à plusieurs reprises que la réforme ne pouvait réussir sans probité, ni exemplarité. La monarchie, consciente du risque de fracture entre le pays et sa jeunesse, tente de réaffirmer une direction morale. Mais cette volonté se heurte à une résistance silencieuse : celle d’un appareil exécutif et administratif qui protège ses privilèges, retarde les décisions, et transforme chaque réforme en opportunité de rente.
Le Maroc a besoin d’un choc de gouvernance. Non pas d’un énième plan ou d’une nouvelle loi, mais d’une rupture réelle avec les logiques d’accaparement. Il ne s’agit plus seulement de moderniser l’économie, mais de purifier la gestion publique. Sans cette réforme de fond, aucune politique ne sera crédible.
La bonne gouvernance ne se décrète pas, elle se prouve. Et tant que le pouvoir politique restera sous l’emprise d’intérêts privés, la fracture entre la parole royale et la pratique gouvernementale continuera de s’élargir. Le risque, désormais, n’est pas la contestation, mais la résignation. Et c’est peut-être la pire des menaces : celle d’un peuple qui ne croit plus à rien, ni à la politique, ni à ses représentants, ni même à la promesse de justice.
Le Maroc est à la croisée des chemins. Soit il choisit le courage — celui de l’intégrité, de la transparence et de la responsabilité —, soit il s’enferme dans un modèle de gouvernance épuisé, où quelques-uns décident pour tous. La monarchie, fidèle à sa mission d’équilibre et de vision, a montré le cap. Mais sans un gouvernement fort, honnête et réformateur, ce cap restera un horizon lointain.
Le pays ne manque ni de ressources ni de compétences. Ce qu’il manque, c’est la volonté politique de rompre avec la corruption, de mettre fin à la confusion entre pouvoir et fortune, et de rendre à l’État sa dignité. Tant que cette bataille ne sera pas menée, le Maroc avancera à reculons : riche en projets, pauvre en justice.
Par Lahcen Isaac Hammouch
Journaliste & écrivain