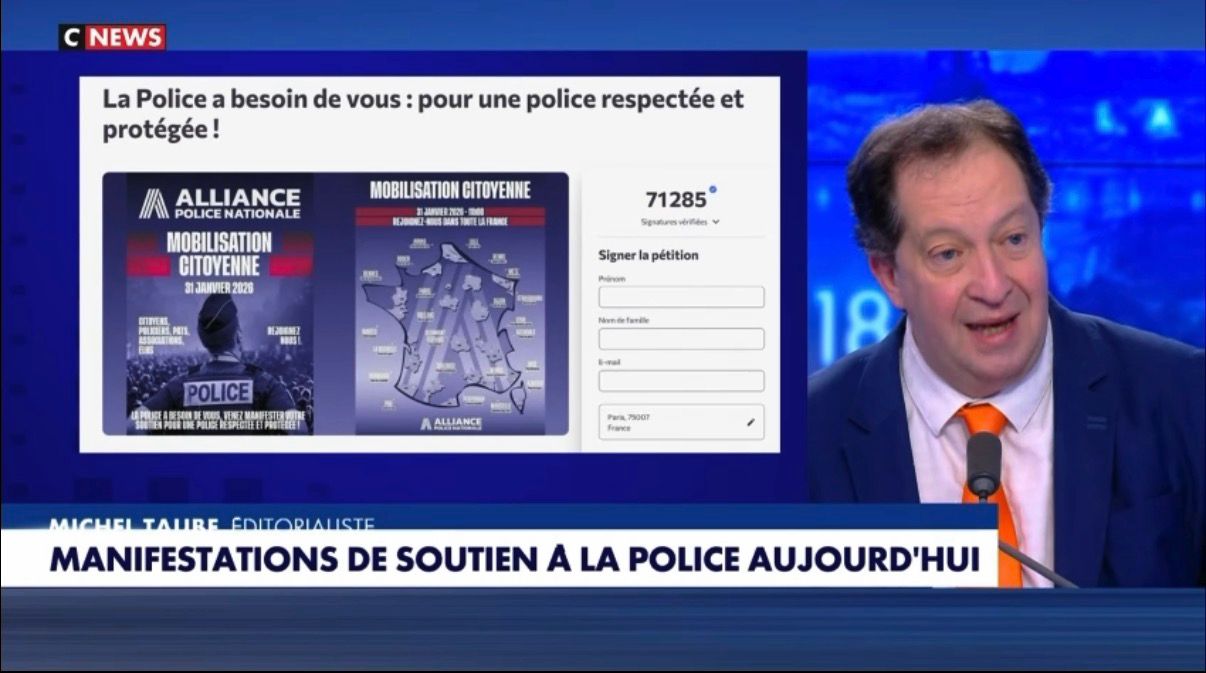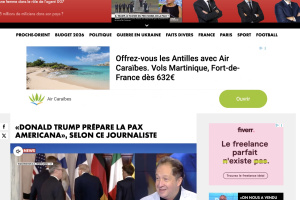Il n’est jamais simple d’incarner à la fois la rigueur et l’espérance. De porter sur ses épaules l’intransigeance de la règle budgétaire et les attentes d’un peuple inquiet. D’affirmer que l’heure est grave, tout en plaidant pour la modération, pour le dialogue, pour la justice. C’est pourtant le pari, presque existentiel, que fait François Bayrou en cet été 2025.
Depuis sa nomination à Matignon à l’hiver dernier, dans un contexte de majorité relative et de désillusion civique, Bayrou n’a cessé d’en appeler à ce qu’il nomme « l’esprit de responsabilité ». Une responsabilité qui n’est ni technocratique ni opportuniste, mais qui relève d’un sens du devoir républicain chevillé au corps. Cela ne rend pas sa tâche plus facile, bien au contraire. Car à une époque où la politique est souvent réduite à des postures, à des indignations bruyantes, à des radicalités pavloviennes, le centrisme paraît presque anachronique. François Bayrou lui-même en a parfaitement conscience. Et c’est pourtant ce cap qu’il choisit de suivre, stoïque.
Le « plan Stop à la dette », qu’il a présenté le 15 juillet dernier, est à la fois audacieux et dangereux. Audacieux, car il tranche dans le vif : 43,8 milliards d’euros d’économies, suppression d’emplois publics, réforme des niches fiscales, gel des retraites, suppression de jours fériés… Aucun Premier ministre sous la Cinquième République n’avait osé aller aussi loin depuis Raymond Barre. Dangereux, car le pacte social français repose encore sur des piliers que cette réforme vient fragiliser.
Bayrou le sait. Il sait que son plan, aussi nécessaire soit-il du point de vue des équilibres macroéconomiques, heurtera les Français dans leur quotidien, dans leur rapport à l’État protecteur, dans cette confiance fragile qu’ils accordent à leurs institutions. Il ne le nie pas. Il l’assume même. Il répète inlassablement qu’il ne s’agit pas de réformer pour réformer, ni de céder à Bruxelles, ni de complaire aux marchés, mais de préparer « le redressement moral et économique de la nation ». Une formule gaullienne, presque messianique, qui en dit long sur la vision qu’il se fait de sa mission.
Ce plan ne sort pas de nulle part. Il est le fruit d’un constat que nul ne peut plus sérieusement ignorer : la dette publique française dépasse les 3 200 milliards d’euros, le déficit reste au-dessus de 5 % du PIB, et la charge de la dette absorbe désormais plus de ressources que le budget de l’Éducation nationale. Si l’on continue ainsi, sans inflexion, la France s’expose à un déclassement économique et politique majeur. Les agences de notation ont d’ailleurs déjà tiré la sonnette d’alarme, tout comme la Cour des comptes.
Mais au-delà de l’économie, c’est bien la politique qui est en jeu. Et c’est là que Bayrou se distingue. Car contrairement à bien des ministres des Finances qui, sous d’autres latitudes, imposeraient de tels plans à coups de décrets ou de consignes européennes, lui cherche l’adhésion, le débat, le compromis. Il négocie avec les socialistes, dialogue avec les élus locaux, rassure les centristes, consulte les partenaires sociaux. Il veut une réforme légitime, non imposée. Une réforme démocratique, pas technocratique. C’est une démarche courageuse, mais périlleuse.
Les oppositions, à droite comme à gauche, flairent le piège. L’extrême droite dénonce un « plan d’austérité à la grecque », quand LFI crie au « coup de force néolibéral ». Même au sein du PS, les voix se font hésitantes. Les syndicats, eux, promettent un automne de colère. Le risque est réel. La situation sociale est inflammable. Le souvenir des Gilets Jaunes reste présent. Mais la situation économique, elle, commande l’action.
Dans ce contexte tendu, François Bayrou incarne une certaine idée de la République. Une République sérieuse, qui ne ment pas sur l’état de ses finances. Une République responsable, qui ne promet pas l’impossible. Une République dialogique, qui ne méprise pas les corps intermédiaires. Il n’a pas la fougue d’un orateur tribunicien. Il n’a pas l’autorité d’un De Gaulle ou d’un Rocard. Mais il a la solidité des hommes de devoir, de ceux qui prennent des décisions difficiles, non pour plaire, mais pour durer.
On peut lui reprocher beaucoup de choses. Une certaine raideur. Une rhétorique parfois datée. Une foi inébranlable dans le pouvoir du verbe et de la morale. Mais on ne peut pas lui dénier sa cohérence. Depuis plus de vingt ans, il alerte sur le déclin des finances publiques, sur le besoin d’un centre fort, sur l’importance de l’éducation, sur la crise du consentement démocratique. Aujourd’hui, il tente de mettre ses principes en pratique. À un âge où d’autres songeraient à la retraite, lui se bat encore. Et seul. Car il faut bien le dire : Bayrou n’a pas de majorité idéologique derrière lui. Il a des alliés de circonstance, des soutiens prudents, quelques fidèles. Mais il n’a pas de base populaire, pas de parti de masse. Il est un Premier ministre sans troupes, un capitaine sans armée.
Cette solitude, pourtant, est peut-être sa force. Car elle l’oblige à convaincre, à justifier, à argumenter. À faire de la politique au sens noble. À chercher des solutions, non des slogans. À préférer les compromis laborieux aux facilités de l’outrance.
Reste à savoir si cette ligne tiendra. Si l’opinion, si les syndicats, si les élus, accepteront de suivre un chemin aussi escarpé. Si la pédagogie suffira à faire passer la rigueur. Si le gouvernement résistera à une motion de censure. Si le centre peut encore être une force motrice dans une France polarisée.
Mais en posant ce plan sur la table, Bayrou a fait plus qu’un acte budgétaire. Il a lancé un défi politique. Celui de la vérité dans un pays lassé des fictions. Celui du courage dans une époque frileuse. Celui de la République au milieu du tumulte. Il faut lui reconnaître cela.
Sofiane Dahmani