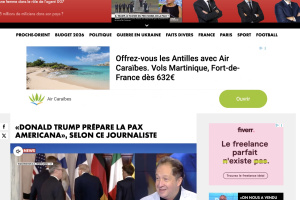Il faut regarder l’Iran tel qu’il est, sans fard, sans filtre, sans les lunettes déformantes de l’idéologie occidentale. Pour la première fois depuis la naissance de la République islamique, le pouvoir vacille réellement. Non pas sous les coups d’une opposition politique structurée, il n’y en a pas, ni sous la pression de l’étranger, il n’est plus écouté, mais parce que les femmes iraniennes ont décidé de ne plus courber l’échine. Depuis quarante-cinq ans, le régime s’est cru invincible en enfermant les femmes, en les voilant, en les fouettant, en les réduisant au silence et en les tuant. Et voilà que celles que les mollahs pensaient avoir brisées deviennent les porteuses d’une révolte nationale dont l’élan dépasse toutes les prédictions. Le pouvoir tombe toujours là où il n’avait pas prévu de résistance.
Le paradoxe est total : plus le régime frappe, plus les Iraniennes avancent. Les arrestations arbitraires se multiplient, les condamnations à coups de fouet tombent comme des sentences médiévales, les prisons se remplissent de journalistes, de chanteuses, d’écrivaines, d’adolescentes coupables d’un foulard trop clair ou d’une mèche visible. Et pourtant, au lieu de reculer, les femmes inventent de nouveaux gestes de défi. Elles allument leurs cigarettes en brûlant le portrait du Guide suprême. Elles retirent leur voile dans les rues malgré les milices. Elles chantent en solo malgré les interdictions. Elles coupent les turbans des religieux dans les bazars. Elles se dressent dans une nudité symbolique contre la police. La répression, loin de les briser, a aiguisé leur détermination. Un pouvoir qui doit intoxiquer des écolières pour maintenir sa domination n’est plus un pouvoir : c’est une panique.
Il faudrait que l’Occident en tire une leçon. On attendait les grandes voix du féminisme français ; on a eu le désert. Pas un mot, pas une marche, pas une indignation, rien. Les théoriciennes de Paris s’émeuvent pour un micro-agacement masculin dans un open space, mais se taisent lorsque des femmes à 4000 kilomètres sont flagellées pour une chanson. Ainsi donc, la solidarité féministe serait à géométrie variable, conditionnée non pas à la gravité de l’oppression, mais à l’identité des oppresseurs. La République islamique l’a bien compris : elle peut emprisonner, torturer, tuer, elle sait que personne ne descendra dans les rues de Paris, Londres ou Berlin pour les Iraniennes.
Mais le cœur du mouvement est ailleurs. Le soulèvement iranien est une révolution anthropologique, pas seulement politique. Les femmes iraniennes ont brisé l’arme ultime du régime : la peur. Et lorsqu’un peuple n’a plus peur, il n’y a plus de soldats assez nombreux, plus de tribunaux assez implacables, plus de prisons assez vastes pour contenir la déferlante. Le pouvoir iranien peut coupure internet pendant cent heures, tirer sur la foule, condamner à mort des militantes pacifiques comme Sharifeh Mohammadi, multiplier les exécutions pour terroriser. Il peut tuer un jeune homme filmé brûlant la photo de Khamenei, et abattre ceux qui l’imitent. Il peut, comme hier l’URSS, imposer un mensonge d’État. Mais il ne peut rien contre une population qui a compris sa propre force. La révolution n’est plus un slogan : c’est un fait.
Il est fascinant d’observer que l’Histoire semble se répéter selon le même mécanisme : ce sont les femmes qui précipitent les fins de régime. Les mères soviétiques ont fait tomber le mythe de l’invincibilité de l’Armée rouge en exigeant des comptes sur les morts d’Afghanistan. Les femmes polonaises ont nourri Solidarnosc. Les mères argentines ont brisé la junte. Les femmes iraniennes, aujourd’hui, jouent ce rôle avec une intensité inégalée. « Révolution » et « révolte » sont des noms féminins, et ce n’est pas une coïncidence linguistique : c’est une réalité historique. Lorsque les femmes s’engagent, le pouvoir tombe, parce que la domination masculine était son premier pilier. Brisez le pilier, et le temple s’effondre.
L’autre vérité, que les analystes occidentaux peinent à saisir, c’est la puissance de la volonté populaire. Les grandes puissances ne tombent pas par manque d’armes, mais par manque d’adhésion. Venise, minuscule cité coincée dans sa lagune, a dominé le monde non par sa taille, mais par la détermination de son peuple. L’Iran, aujourd’hui, a cette même énergie. Les mollahs ne comprendront jamais cela : l’obéissance obtenue par la terreur n’est pas de l’autorité, c’est une expiration lente. Les Iraniens, eux, n’ont plus peur. Ils n’ont plus confiance. Ils n’ont plus rien à perdre. Et un peuple qui n’a plus rien à perdre est un peuple qui va gagner.
Alors oui, le régime iranien peut tomber. Non pas demain par un décret international, non pas sous les applaudissements hypocrites des chancelleries occidentales, mais par la seule volonté d’un peuple mené par ses femmes. L’Histoire retiendra que la fin des mollahs n’a pas commencé dans un palais, mais dans la rue, sur les toits, dans les prisons, dans les écoles, dans les chants interdits et les foulards brûlés. Le pouvoir croyait tenir les femmes enchaînées ; ce sont elles qui tiennent désormais entre leurs mains le destin du pays. Et cette fois, personne ne pourra les arrêter.