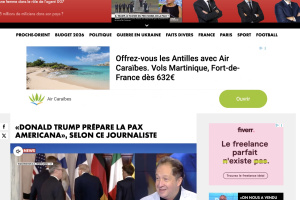Donald Trump inquiétait les démocraties et on le croyait préférant les pouvoirs autoritaires : l’arrestation du chef d’État vénézuélien Nicolas Maduro dans sa capitale, le 3 janvier 2026, par l’armée américaine et le FBI rebat les cartes… mais peut-être pas celles que l’on croit.
Qui regrettera Nicolas Maduro, à part ceux qui bénéficiaient de son système de corruption ? Son passage à la tête du Venezuela (2013-2026) à la suite de son mentor Hugo Chavez (1998-2013) aura été synonyme de dictature d’extrême gauche, de fraude aux élections, de misère et de terreur politique. Pour mémoire, depuis l’arrivée au pouvoir de Nicolas Maduro, le PIB du Venezuela a été divisé par quatre et 8 à 9 millions de Vénézuélien ont émigré, soit près du quart de la population, selon l’ONU.
Le régime vénézuélien ne tenait que par la corruption des services de sécurité grâce à l’argent issu du narcotrafic (acheminement de la cocaïne produite en Colombie vers les États-Unis) et du détournement de la rente pétrolière (ou de ce qu’il reste de cette grande richesse du pays après l’effondrement de la production passée de 3 millions de barils par jour à moins de 1 million sous Chavez et Maduro, à force de mauvaise gestion et de manque d’investissement). Le tout avec le soutien actif de Cuba, de l’Iran, de la Chine et de la Russie, pourvoyeurs de garde prétorienne, de méthodes de contrôle social et politique, et de techniques de surveillance.
Ainsi, on a tout lieu de se réjouir de l’arrestation par l’armée américaine et le FBI de celui qui est accusé, depuis son inculpation en 2020 par l’administration de Joe Biden, de narcotrafic et de narcoterrorisme – ainsi que de crimes contre l’humanité par la mission des Nations unies mandatée depuis 2019 par le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU – et qui sera jugé aux Etats-Unis où il était considéré comme un fugitif, et recherché (« Wanted ») par la Justice, sa tête étant d’abord mise à prix à 25 millions de dollars puis, depuis quelques mois, à 50 millions de dollars.
L’arrestation, racontée par le chef d’état-major de l’armée américaine est stupéfiante d’audace opérationnelle, mais elle est aussi saisissante sur le plan politique.
La « doctrine Donroe » n’est ni MAGA ni neocon mais « America (and Money) first »
Il convient cependant de relever qu’il s’agit de la chronique d’une intervention annoncée, entre accumulation depuis plusieurs mois au large du Venezuela de « la plus importante armada jamais vue dans la mer des Caraïbes » (selon Donald Trump), la publication de la Stratégie de Sécurité nationale des États-Unis en décembre (« America First », doctrine Monroe actualisée, désengagement global, équilibre avec la Russie et rivalité assumée avec la Chine) et annonce haut et clair par Donald Trump du départ prochain de Maduro, d’une façon ou d’une autre. Nous sommes désormais habitués à la capacité du président américain à prononcer les énormités les plus improbables, aussi à ce qu’un certain nombre d’entre elles se concrétisent.
En l’occurrence il s’agit, comme il a lui-même commencé à l’expliquer, de l’application de la « doctrine Donroe », néologisme désignant l’actualisation de la « doctrine Monroe » (énoncée en 1823 par le président James Monroe, qui entend alors mettre un terme à la colonisation du continent américain et à toute intervention européenne sur celui-ci) à la mode « Donald ». Ce qui d’ailleurs doit légitimement faire trembler les régimes de Cuba et du Nicaragua (n’oublions pas le Nicaragua au rang des trois dictatures subsistant en Amérique latine), tous deux dans le viseur du Secrétaire d’État Marco Rubio, élu floridien descendant d’émigrés cubains anticastristes et spécialement déterminé à éradiquer les dictatures d’extrême-gauche du continent américain.
D’apparence contradictoire avec l’isolationnisme et le refus de toute intervention extérieure par la fraction MAGA (les tenants du slogan « Make America Great Again ») de son électorat (représenté dans son entourage proche par le vice-président JD Vance, d’ailleurs absent de la conférence de presse qui s’est tenue le 3 janvier à 17h00 à Mar-a-Lago), cette intervention ne rejoint pas non plus l’approche néoconservatrice des présidents Reagan (1981-1989) et Bush fils (2001-2009), qui consistait à exporter le modèle démocratique et libéral dans des pays, des régimes, ou des sociétés qui n’en voulaient pas ou n’étaient pas forcément prêtes à l’accueillir.
Cette intervention, dans la propre bouche de Donald Trump, a trouvé trois justifications de politique intérieure des États-Unis : la lutte contre le narcotrafic et son corollaire de milliers de morts de consommateurs, la nécessité de permettre aux Vénézuéliens exilés aux États-Unis et ailleurs de retourner dans leur pays dans des conditions optimales de sûreté et de prospérité, et celle de rembourser les entreprises pétrolières américaines à la suite de leur spoliation par les nationalisations de Hugo Chavez, en leur permettant d’investir dans le secteur pétrolier en échange d’une part de la rente pétrolière.
Au Venezuela, un peu d’espoir, beaucoup de questions
Et c’est là que l’on ne comprend plus, ou que l’on ne comprend que trop. Inutile de préciser que, dans le cas présent, il nous faut faire le deuil du droit international des conflits, cette belle idée qui n’a existé seulement que de façon très temporaire, pour ne pas dire marginale, dans l’histoire moderne à travers en particulier la Charte des Nations-Unies.
Pas une fois Donald Trump n’a mentionné lors de son propos explicatif la « liberté », la « démocratie » ou l’opposition politique vénézuélienne démocratique, qu’elle soit clandestine, exilée ou emprisonnée. En revanche, il est revenu à de nombreuses reprises sur la démonstration de puissance des États-Unis qui doit, en effet, édifier tous ceux qui seraient tentés de leur faire de l’ombre, et il a lourdement insisté sur le pétrole, sur l’argent du pétrole, et son intention transparente, affichée, assumée – peut-on encore dire cynique à ce stade ? – de s’emparer de l’ensemble du secteur et d’une partie de ses bénéfices économiques.
Pas un mot sur le président Edmundo Gonzalez Urrutia, largement élu en 2024 mais contraint à l’exil en Espagne, après la proclamation de la victoire de Maduro en dépit de l’évidence.
Pas un mot de Maria Corina Machado, cheffe de l’opposition vénézuélienne, triomphalement désignée avec plus de 90% des voix dans la primaire qui a précédé l’élection présidentielle (avant d’être interdite de se présenter par l’administration de Maduro pour des prétextes divers), et devenue Prix Nobel de la paix 2025… un Prix auquel Donald Trump aspirait. Peut-être lui tient-il rigueur de l’avoir devancé, même si elle lui a aussitôt dédié sa récompense et a toujours soutenu son action à l’encontre du Venezuela de Maduro ?
Au contraire, Donald Trump l’a gratifiée d’une déclaration aussi lapidaire qu’injuste sur le « manque de respect et de soutien » dont elle disposerait pour jouer un rôle dans l’immédiat au Venezuela.
Le résultat, pour l’instant, est que c’est Delcy Rodriguez, vice-présidente du Venezuela désignée par Nicolas Maduro qui assume le pouvoir à sa suite, sous la pression intense et la menace directe de l’administration Trump et de son armada, « aussi longtemps qu’elle fera ce que nous voulons », d’après le président des Etats-Unis. De fait, l’administration américaine n’a pas présenté d’autres modalités de gestion concrète de la transition, au-delà de son intention affirmée de gérer directement le pays et son pétrole.
Il faut y voir là, tout d’abord, un signe supplémentaire du mépris dans lequel Donald Trump tient les notions de « liberté » et de « démocratie », ce qui n’est pas de nature à rassurer ceux qui considéraient que le départ de Maduro marquerait la fin de son régime et le retour aux libertés politiques, la fin de la terreur, de la corruption et le début d’une renaissance économique et politique pour le pays…
On est encore très loin de ce scénario et il n’est pas exclu qu’une forme de quasi statu quo sur ces aspects accompagne l’investissement américain dans le secteur énergétique.
Il ne faut du reste bien sûr pas sous-estimer les colossales difficultés qui accompagneront la transition pourtant nécessaire et qu’il faudra bien affronter, le plus tôt sera le mieux. Les États-Unis ont semble-t-il tiré les leçons de l’échec radical des changements de régime d’inspiration néoconservatrice, imposés au début des années 2000 en Irak, en Afghanistan et plus tard en Libye, qui se sont traduits par la destruction complète de la structure sécuritaire et étatique existante au nom de la purification, de la justice, quand ce n’est pas de la vengeance, provoquant anarchie, chaos et un déséquilibre durable à l’échelle de tout le proche Orient et l’Afrique du Nord.
La situation est certes différente au Venezuela, qui existe principalement par sa structure sécuritaire répressive, et où à peu près tout le reste (secteur privé et services publics) est en ruines. En réalité, tout est à reconstruire sur de nouvelles bases et la tâche est immense. Il ne faut en outre pas négliger, au-delà de ceux qui soutenaient le régime par intérêt et qui changeront de loyauté à la première occasion, les ravages de 27 ans de propagande chaviste intense sur une frange non négligeable de la population qui aura plus de difficultés à admettre le changement.
Nouvel ordre du monde : le changement, c’est maintenant
À l’échelle régionale comme à l’échelle planétaire, les alliés politiques des États-Unis ont applaudi, les adversaires ont désapprouvé pour le principe et au nom du « respect du droit international » comme l’a précisé très sérieusement la Russie. Nous l’avons vu, les dictatures extrême-gauche à Cuba et au Nicaragua peuvent légitimement être inquiètes pour leur survie à court terme. Quid du canal de Panama et du Groënland, pour lesquels Donald Trump n’a pas caché son intérêt ? Bien malin qui pourrait le dire, mais rien n’est à exclure… À quoi doit s’attendre la Colombie, principal exportateur de cocaïne et dont le président communiste Gustavo Petro est un adversaire acharné des États-Unis ? Certainement à des rodomontades (« Petro ferait mieux de faire gaffe à ses fesses » dixit Donald Trump), peut-être à des frappes américaines au sol, destinées à des narcotrafiquants aujourd’hui principalement sous le contrôle des guérillas contre lesquelles lutte aussi l’État. Mais la situation y est très différente de celle du Venezuela : la démocratie colombienne fonctionne, et le président Petro quittera la tête de l’État après la prochaine élection présidentielle prévue le 31 mai et le 21 juin 2026. On peut gager que Donald Trump, comme il a pris l’habitude de le faire lors des élections en Amérique latine, s’ingèrera de tout son poids dans le processus électoral colombien afin de l’influencer dans le sens du candidat qu’il aura désigné comme son champion.
Du côté de l’Iran, la dictature des mollahs, ébranlée par ailleurs par un puissant mouvement populaire, perd au Venezuela un allié précieux pour ses ressources et pour le soutien qu’il apportait à ses « proxys » comme le Hezbollah libanais, impliqué dans le narcotrafic sur une bonne partie du continent latino-américain.
Pour la Russie comme pour la Chine – cette dernière étant devenue le premier partenaire commercial de la région et un investisseur majeur dans ses infrastructures, ses ressources agricoles, minérales et énergétiques, en même temps qu’elle est le rival stratégique principal désigné par les États-Unis – le message de la doctrine Donroe est clair : « nous vous ferons reculer sur le continent américain ». Ces deux puissances verront cependant dans cet épisode la confirmation de l’effacement du droit international, ou de ce qui lui servait encore d’apparence, et s’en souviendront dans leur convoitise respective de l’Ukraine et de Taiwan.
Ainsi, au lendemain de l’arrestation de Nicolas Maduro, on doit saluer pour le Venezuela la fin d’une période de glaciation, où toute évolution politique et donc économique semblait être impossible, même si de nombreuses inconnues subsistent. Pour le reste du monde, Donald Trump, Marco Rubio et Pete Hegseth, le Secrétaire à la Défense l’ont répété : les États-Unis sont de retour et ils déploieront toute leur puissance au service de leurs intérêts comme bon leur semble.
Laurent Tranier
Chef de la rubrique Amérique latine – Opinion Internationale