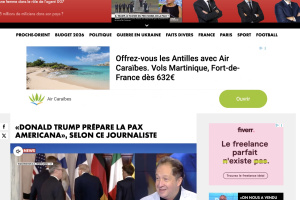Le discours prononcé par le roi Mohammed VI le 10 octobre 2025 restera sans doute comme l’un des plus étranges et les plus déroutants de son règne. Ce n’était pas un discours d’autorité, ni un discours d’apaisement. C’était une allocution creuse, mécanique, presque impersonnelle, prononcée par un souverain fatigué, à la voix hésitante, au regard absent. Mais au-delà de la forme, c’est surtout ce que le discours n’a pas dit qui bouleverse le pays : le roi n’a pas répondu à la question qui obsède les Marocains depuis des mois — que compte-t-il faire d’Aziz Akhannouch ?
Le silence royal sur cette question a eu l’effet d’un séisme. Car le chef du gouvernement est devenu, dans la conscience collective, le symbole même de la faillite morale et politique du régime. Homme d’affaires prospère, milliardaire de l’or noir, il dirige un pays qu’il ne comprend pas. Ses décisions technocratiques, sa communication arrogante, son incapacité à parler la langue du peuple ont fini par l’isoler. Autour de lui, le gouvernement ressemble à un conseil d’amis : des proches, des associés, des figures liées par des réseaux familiaux et économiques. La politique, vidée de toute substance, est devenue un cercle fermé. Et pendant ce temps, les prix flambent, la dette publique explose, et la jeunesse s’exile.
Le peuple n’attendait qu’une chose : un geste royal, une sanction symbolique, une preuve que la monarchie reste du côté de la justice. Mais le roi s’est tu. Ce mutisme n’a pas été perçu comme de la prudence, mais comme une démission morale. Pour la première fois, le souverain est apparu comme protecteur d’un gouvernement honni. Ce silence a creusé le fossé déjà béant entre le roi et son peuple. Car lorsque l’arbitre refuse de siffler la faute, tout le match devient illégitime.
Pour comprendre cette rupture, il faut revenir en arrière. Au début de son règne, Mohammed VI incarnait l’espoir. En 1999, il était jeune, moderne, empathique ; il parlait de droits des femmes, de lutte contre la pauvreté, d’ouverture et de justice. Son image contrastait radicalement avec celle de son père, Hassan II. Les premières années ont été celles des réformes symboliques : l’Instance Équité et Réconciliation, le Code de la famille, la libéralisation des médias, le Maroc tourné vers l’Afrique et l’Europe. Le peuple croyait à “M6”, le roi du renouveau.
Mais au fil des années, ce capital de confiance s’est érodé. Les grandes promesses du “modèle de développement” se sont diluées dans la bureaucratie et le népotisme. La réforme constitutionnelle de 2011, issue du Printemps arabe, n’a jamais produit la séparation des pouvoirs attendue. Le roi a gardé les leviers essentiels ; le Parlement et le gouvernement sont restés des figurants. Puis, à partir de 2016, le système s’est replié sur lui-même : marginalisation des voix critiques, contrôle accru des médias, instrumentalisation des institutions. L’ascension d’Aziz Akhannouch, homme d’affaires proche du palais, a symbolisé cette fusion toxique entre argent et pouvoir : la politique est devenue un prolongement des affaires.
Dans le même temps, le monde autour du Maroc a changé. Les équilibres régionaux se sont effondrés : la guerre en Ukraine, la rivalité entre l’Occident et la Chine, la montée des tensions avec l’Algérie, la stagnation des investissements européens, les conséquences climatiques sur l’agriculture. Tout cela a fragilisé une économie déjà inégalitaire. Le royaume, longtemps vanté comme un modèle de stabilité, apparaît désormais isolé, incapable de se réinventer. Le “soft power” diplomatique du Maroc s’effrite à mesure que son image intérieure se dégrade : les chancelleries occidentales s’inquiètent d’un pouvoir opaque, d’une dette incontrôlée et d’une jeunesse en rupture.
Car la rupture, justement, vient de là. La génération Z marocaine — celle des 18–30 ans, connectée, éduquée, mais sans perspectives — a cessé de croire. Elle ne réclame pas un changement de régime, elle réclame la fin de l’hypocrisie. Elle ne craint plus le roi ; elle l’observe, le juge, le commente, parfois le ridiculise. Sur TikTok, sur X, sur Instagram, la monarchie a perdu le monopole du récit national. Le pouvoir ne parle plus seul. Chaque parole royale est disséquée, traduite, détournée. Cette génération ne se nourrit plus de discours, mais de vérité. Et c’est peut-être ce que le régime ne comprend pas : le langage du contrôle ne fonctionne plus dans une société d’hypertransparence.
À cette fracture politique s’ajoute une fracture sociale abyssale. D’un côté, une élite urbaine, concentrée à Casablanca, Rabat ou Marrakech, qui vit dans un confort mondialisé : écoles privées, villas, vacances en Europe, fortunes délocalisées. De l’autre, une majorité silencieuse qui survit dans l’informel, dans les villages oubliés, les quartiers périphériques, les administrations déshumanisées. Ces deux Maroc ne se rencontrent plus. L’un vit dans le fantasme du “pays émergent”, l’autre dans la fatigue du quotidien. Cette ségrégation invisible alimente la colère et l’humiliation. Le Maroc, nation une et indivisible en apparence, est devenu un archipel social.
Dans ce climat de fracture et de désillusion, le roi semble lui-même prisonnier de son propre système. Ses apparitions publiques sont rares, ses voyages limités, ses décisions lentes. Autour de lui, les clans du palais — entre les sécuritaires, les économiques et les technocrates — se livrent une guerre froide silencieuse. Certains disent que le souverain se méfie de tout le monde, et que tout le monde se méfie de lui. Le pouvoir, jadis vertical, est devenu fragmenté. Il n’y a plus de centre clair. Et cela, dans une monarchie absolue, est le signe d’une crise de structure.
L’unique horizon évoqué discrètement par certains cercles proches du pouvoir est celui du prince héritier, Hassan Ben Mohammed. À vingt-deux ans, il est déjà médiatisé, préparé, mis en scène comme le futur du royaume. Intelligent, réservé, il incarne la continuité dynastique. Mais sa jeunesse ne suffira pas à redonner foi à une société qui n’attend plus de symboles, mais des actes. La transition générationnelle ne sera crédible que si elle s’accompagne d’une révolution morale : la fin du népotisme, la transparence dans la gestion publique, la reddition de comptes et la séparation réelle entre politique et richesse privée. Sinon, le jeune prince ne sera qu’un visage neuf pour un système ancien.
Tout le défi du Maroc est là : comprendre que la stabilité n’est plus garantie par le silence, mais par la confiance ; que l’autorité n’est plus héritée, mais méritée ; que la légitimité ne vient plus de la lignée, mais de la vérité. Le pays est à un carrefour. Il peut choisir de s’ouvrir, d’écouter sa jeunesse, de repenser son modèle économique et institutionnel. Ou bien persister dans la peur, la communication creuse, les manœuvres de cour.
Le Maroc n’a pas besoin d’un miracle, mais d’un sursaut de sincérité. Si le roi trouve encore en lui la force d’un geste moral, s’il se défait des courtisans et des intérêts privés, s’il tend la main à cette génération blessée mais pleine d’intelligence, alors le pays peut renaître. Mais s’il continue à protéger l’incompétence, à tolérer l’injustice et à se réfugier dans le silence, il perdra ce qui faisait sa singularité : l’équilibre entre autorité et affection.
La monarchie marocaine a survécu à des tempêtes plus violentes. Mais celle-ci est d’une autre nature : ce n’est pas une crise politique, c’est une crise de foi. Et aucune institution, aussi ancienne soit-elle, ne survit longtemps à la perte de foi de son peuple.
Par Lahcen Isaac Hammouch
Journaliste & écrivain