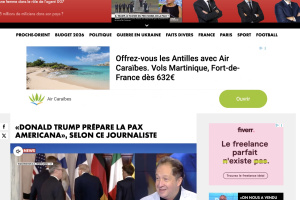Certains de nos compatriotes parlent de « grand remplacement » — des Européens par les Africains, pour faire court — mais ce qui restera de ces trente années hideuses (1990-2020), c’est un mouvement autrement ample ! Appelons ce processus et cet aboutissement : « le grand renfermement ». Et cette contention, soyons-en bien certains ! concerne cette fois tout le monde : visages pâles, moins pâles, jaunes et même écossais !
Un homme de ma génération, né dans l’air libéré des années d’après la guerre mondiale, la deuxième, une période d’optimisme, un enfant grandi à l’air libre, son vélo dépourvu d’antivol posé contre la boulangerie et jamais « emprunté », un adolescent qui descendait la vitre à mi-hauteur dans les bus et s’en trouvait remercié par ses aînés, un homme dont les fenêtres du logis restaient ouvertes et qui a pu entrer sans passeport dans nombre de pays, a vu — comme nous tous — se resserrer le monde. De toute ma vie, c’est le phénomène le plus frappant, évident : le grand renfermement.
La première chose qui m’a étonné lorsque, alors magistrat, je suis entré dans les cliniques gériatriques du 9-2 — les EHPADs, pour parler selon les modernes — ce sont les vitres. Elles étaient scellées, et seule une mince portion de la fenêtre pouvait coulisser, sur une hauteur inférieure à dix centimètres, sur une largeur de quinze-vingt centimètres. On craignait quoi ? Une évasion de Grand-mère descendant les étages de l’immeuble, les draps noués au pied de son lit scellé ? Des cambriolages de couches-culottes ? Ne cherchez pas dans les 1187 mesures prônées par nos actuels réformateurs après le « choc Victor Castanet », nos braves administratifs n’ont pas consacré une ligne au principe — et seulement le principe ! — de ce « grand renfermement » de nos Aînés.
Cette contention ne frappe en vérité pas les seuls Anciens, qui en sont en quelque sorte l’achèvement, le couronnement… du système. Soleil Vert, en 1973, un film d’anticipation… Une œuvre de H. Harrisson dès 1966 ! Cette contention avait effectivement commencé, par les codes d’immeuble, parfois doublés : code d’immeuble, code d’escalier, interphones, vigiles… ça a continué avec les alarmes en tous genres, comme celles qui hurlent, du cœur des motos stationnées, les jours de tempête, les motos traînées par le vent sur le bitume. Puis ensuite, dans les entreprises ou ailleurs : badge ici, badge là, pass ceci, pass cela… Dans les années 2010, cela me faisait sourire : car au tribunal de Nanterre — le temple de la Loi (…) — c’était la même chose. Il m’avait fallu créer un véritable « incident » pour ouvrir une cloison vitrée, à l’évidence encrassée depuis des lustres, et chasser l’atmosphère putride d’une salle d’audience bondée.
Ce qui est le plus frappant, c’est la mutation de notre espèce. Aucune femme, aucun homme de la génération de guerre, de résistance au sens étymologique, celle de mes parents, n’aurait accepté d’être ainsi « contenu » dans ces trains et bus fermés — le système des minuscules cloisons coulissantes s’est répandu partout — et la déshumanisation — tapez dièse, tapez étoile — qui prévaut désormais. Écrans plats prévalant sur la conversation, et gestes « barrière » interdisant les contacts physiques. Ces années hideuses (1990-2022) sont bien celles, non pas de l’ouverture au monde, mais de l’enclosure de notre espace — j’allais écrire « espèce » — occidental. D’autres, avant moi, avaient prévu ce basculement vers une « asiatisation » du monde.
À Mishima — nom d’une ville japonaise avant de devenir le pseudo littéraire du grand écrivain nippon (1925-1970) — j’avais vu, il y a maintenant des décennies, ce qui était inimaginable pour un Français, habitué à suivre les vaches et autres moutons évoluant dans les prés, sur le flanc des collines et les vallons herbagés : un hangar de fer accueillant, de leur naissance à leur départ pour l’abattoir, des bovidés nés dans cet enclos Mishima et n’ayant pour ainsi dire jamais vu la lumière du jour. J’étais horrifié. Les éleveurs japonais avaient certes une excuse : le manque cruel de place, 120 millions de Japonais devant se partager la moitié de la France, avec de larges zones inhabitables, voire dangereuses. Vingt trente ans plus tard, la France est « nipponisée » : masques anti-Covid, plexiglass et cloisons, peur d’empoisonnement partout, du supermarché bio à la réunion de famille.
Hiroshima n’a pas fini d’exploser. Et le nom, le nuage de Tchernobyl, qu’une présentatrice de la météo française avait tenu à distance par un panneau « stop » en 1985 — il faut revoir la séquence ! l’humour noir à son sommet ! — revient sur les devants de la scène. Hiroshima, Tchernobyl, Fukushima… Tchernobyl sous le feu de la guerre. Quel bond en arrière ! Notre nouvelle époque, jurassique !
Dans un même mouvement, la laideur imposée par des architectes « disruptifs » — et leurs commanditaires jamais en panne d’un « coup de pub » – a envahi l’espace public, avec la criminalité qui va avec. Dans une nouvelle prison qu’alors avocat, je visitais, j’avais vu des murs rouge vif ! Ah ! les grands psychologues ! Trente réunions trans-professionnelles à la Chancellerie pour parvenir à ce sommet ! De l’art de calmer les détenus !
Mais le pire n’est pas là. Le pire, c’est le blanc hospitalier. On l’oublie toujours : le blanc est la couleur du deuil. Je ne sais pas exactement quand on est passé en Europe du blanc au noir. En Chine, le blanc est demeuré pour les cérémonies funéraires.
Cher lecteur, vous voyez les murs d’un hôpital ? Blancs, toujours blancs… Pas une peinture — ou si laides—, pas une sculpture, ou un simple bel objet. Seul l’hôpital Saint-Louis du brave Henri IV offre des recoins qui facilitent la rémission, le calme, qui sait ? la guérison des cœurs. Mais partout, pourquoi ce blanc ou ce vert-amande clair, couleur aquarium délavé ? On nous donne des raisons aussi peu fondées les unes que les autres. Et demeurent valables les vers (1910) de Mallarmé dans le poème si bien nommé Les fenêtres : « Las du triste hôpital Et de l’encens fétide » et on oubliera la suite « Qui monte en la blancheur banale des rideaux » Il n’y a plus de rideaux, mais la blancheur est restée !
Les arts — exceptés de rares clowns pour les enfants et de tristes clowns administratifs pour les aînés — sont chassés de l’hôpital, ou concentrés dans musées et fondations. L’art n’est plus qu’une réserve indienne. Ce monde devient laid et triste. Nous sommes tous des Ukrainiens chassés de nos racines.
Danse ? Les discothèques ont été les lieux les plus fermés, parmi mille autres commerces (2020-2022). Et l’absence de mouvement physique des « confinés » les bien nommés, a été dénoncée par les psychiatres, et autres praticiens, comme une des causes de nombre de nouvelles pathologies. Cinémas ? fermés ou en péril… Théâtres ? Oublions ! Peinture, sculpture ? Finalement, comme la musique est aussi interdite et ne peut s’écouter qu’en mode « fermé » avec écouteurs, reste un seul espace de liberté : Le parfum.
Dans tel couloir d’hôpital est passée une femme que je ne connais pas, transportant avec elle les effluves d’un parfum de… 1967. Je m’en rappelle parfaitement, et comme la madeleine de Proust, elle a permis une véritable évasion. Évasion, le seul mot qu’il faut retenir !
Jean-Philippe de Garate