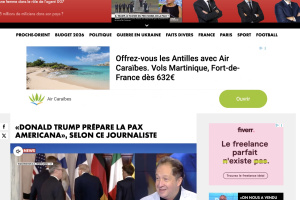Une oeuvre de Jaëraymie
A n’en pas douter, je suis d’une génération que les États-Unis ont fait rêver. Né à Paris dans les années 60, je suis Américain. « I love America » comme Patrick Juvet.
Je me souviens des heures passées sur l’écran noir et blanc de la télé de l’époque à regarder les premiers pas d’un homme… sur la lune. Les allers retours à la fenêtre de l’appartement de banlieue pour voir si je voyais effectivement Armstrong, Aldrin sur la lune, émerveillé… Mammy, il y a des types là haut… J’avais 7ans. « Un petit pas pour l’homme, un grand pas pour l’humanité ».
Je me souviens des grands films du dimanche soir que l’on regardait avec mes parents, c’était notre messe du dimanche à nous : de John Wayne, Mac Queen, Stewart, Newman, Bronson, des grands westerns… Des premiers feuilletons, Starsky et Hutch que l’on mimait dans les rues de Grenoble, stoppant net la voiture, ouvrant la portière le plus rapidement possible, roulé boulé, se retrouvant à genoux en chantant goguenard, “starskyyyyyy et Hutch…”. Et de bien d’autres films manichéens où les bons et la liberté triomphaient toujours. Parfois d’un méchant industriel ou propriétaire cupide qui voulait agrandir ses terres aux dépends des villageois qu’il tuait ou rinçait. De la gueule des hommes de main qui finissaient invariablement par mordre la poussière.
Je me souviens des premiers westerns spaghetti, de Clint Eastwood, de Fonda, des premiers films en couleurs, du Lauréat, de la Dernière Séance.
Je me souviens de toute cette musique qui a déferlé dans nos tympans de nouveaux nés au monde libre, du rock, du pop, de cette nouvelle jeunesse en jean et cheveux longs, chemise ouverte à grand col et pantalons patte d’Eph, mes aînés de quelques années qui allaient construire un nouveau monde forcément meilleur : libéré et allant de l’avant sous l’impulsion des États-Unis.
Je me souviens qu’en 1977 mes parents, se saignant aux quatre veines, m’ont envoyé aux État-Unis, un mois en Californie, vivre ce rêve éveillé d’une jeune nation qui devenait un phare pour la planète entière, avec un peps de dingue où le moindre truc était le plus grand du monde, tellement on rêvait haut et fort. Je me souviens des premières grandes voitures que je ne voyais que dans les feuillletons, des Cadillac, des Chevrolet, de ma famille d’accueil, un ex Marine un peu sourdingue avec qui j’ai correspondu longtemps, d’une classe et d’une gentillesse incroyable, de sa petite villa avec piscine dans la banlieue de L.A, typique de l’american way of life de magazine. Il illustrait tous les derniers combats du monde libre contre la tyrannie, la dictature, un monde de principes pour fabriquer ce nouveau monde meilleur, à n’en pas douter. Les principes, les siens qui l’avaient mené sur beaucoup de champs de bataille pour servir l’oncle Sam, avaient du sens. Ce n’était pas pour le pétrole, pour une cause foireuse, pas adoubée par l’ONU. Tout y était démesuré, XXL pour un frenchie de Grenoble. Je me souviens de l’un de mes premiers flirts, une Américano mexicaine ou cubaine je ne sais plus, Rhonda je crois. Je me souviens du L.A. de ces années-là, de Frisco, de Las Vegas.. Papa je veux être Américain !!!
Je me souviens de mon embauche chez Shearman Sterling, cabinet de conseils US, comme jeune juriste en 1992 et du premier vol en Concorde en revenant de New York car le travail était récompensé. L’échec était sanctionné, sans remords ou questionnement, des règles claires comme dans les grands westerns. Du petit mot du patron de Shearman monde me souhaitant la bienvenue avec gentillesse, fier de m’avoir « on board » alors que je ne représentais rien de rien, sauf peut-être l’avenir, qui sait. Galvanisant forcément quand on est au début de tout et que tout a figure d’exemple.
Et puis je me souviens aussi de mes premiers doutes, puis des premières vraies interrogations.
De mon prof en Prép ENA me disant que les Etats-Unis gagneraient la grande bataille mondiale du commerce et de la démocratie, car ils allaient exporter du coca-cola partout et le mode de vie qui va avec, ralliant ainsi les populations sous leur bannière où aujourd’hui les étoiles qui brillent sont désormais plus celles de la consommation que celles de la liberation des peuples et des nations. Je me disais déjà refoulant une pensée iconoclaste peu en phase avec cette époque où tout semblait joué: et si tout le monde ne veux pas vivre comme cela ? N’est-ce pas un peu arrogant de vouloir niveler tout le monde à son image ? Et si cela provoquait des réactions inverses ? Du rejet plus que de l’admiration ? Pourquoi un Afghan serait-il heureux et fier de boire du coca ? Le coca pouvait-il renverser des traditions séculaires, importer la démocratie, un modèle non souhaité ? L’Amérique ignorait-elle les bases même de l’histoire, de la géographie, de la sociologie et de l’anthropologie ? Que l’on ne gomme pas l’histoire comme cela. J’étais à la fac.
Du bouquin « Après l’empire » ou « l’empire n’aura pas lieu » d’Emmanuel Todd qui fut un choc, alors qu’au même moment, comme face à un miroir grossissant, je négociais une opération avec des industriels américains d’une dureté incroyable et pour qui seul le rapport de force comptait. Sans principes, avec pour seul Dieu l’argent comme source de tout, qui permet tout, comme fin et moyen de tout à la fois. Un Dieu qui avalait tout sur son passage, un Dieu des puissants qui oublie le reste de l’humanité, ce petit reste qui finira peut-être par leur courir après pour leur réclamer leur part du gâteau. On broie, on n’élève personne.
D’une conversation avec l’oncle énarque d’un ami à qui je disais « et si le prochain désordre mondial venait des États-Unis » ne voulant pas lâcher leur leadership pour un monde plus équilibré, ignorant que l’histoire a ses propres forces d’entraînement contre lesquelles on ne peut rien faire. Et de l’engueulade moralisatrice qui s’en est suivie, osant avancer l’idée que nos sauveurs et la proue du monde libre pourraient un jour être du mauvais côté de l’histoire. Nous étions au début des années 90. Un mauvais pressentiment.
D’une rencontre avec des représentants démocrates et républicains à Washington et de leur réponse à un jeune étudiant béninois qui leur demandait, avec un brin de malice et de témérité juvénile, pourquoi son pays n’avait pas accès au « conseil de sécurité de l’ONU », s’il ne fallait pas repenser la gouvernance de l’ONU et des grandes organisations internationales .Alors que la réponse démocrate faisait montre de compréhension, de diplomatie et de louvoiement, je me souviens de la réponse du républicain, qui disait grosso modo : « le Bénin est trop petit pour compter et on n’en a rien à foutre ». Une fracture de langage que l’on retrouve aujourd’hui avec l’élection de Trump, sans qu’elle illustre forcément une fracture de pensée, simplement un écart entre la forme et le fond. Comment ensuite convaincre l’étudiant béninois, qui peut être un jour sera président dans son pays, après une réponse si brutale, que les États-Unis sont bienveillants et les défenseurs de la démocratie ?
Je me souviens du 11 septembre 2001 faisant basculer le monde dans une période post empire, du regard du président américain Bush qui ne pouvait comprendre ce qui se passait et le sens de cet événement.
Je me souviens de la deuxième guerre en Irak, des Etats-Unis avançant devant un monde éberlué des preuves qui n’existaient pas pour justifier une action militaire dont les motivations profondes étaient toutes autres et qui a déstabilisé le monde pour longtemps ; peut-être était-ce d’ailleurs l’effet recherché, bien au-delà de l’appropriation de ressources pétrolières régionales. Mettre le bazar dans le monde et en Europe, qu’il faut à tout prix déconstruire pour sauvegarder encore quelques années sa place de numéro un mondial. Quelle nation civilisée aurait-elle pu ouvertement dire autant de mensonges ? Je pense à Frédéric Pierucci enfermé pendant plus de deux ans aux Etats-Unis, arrêté en avril 2013 (c’était sous la présidence d’Obama) à la sortie de l’avion à New York pour peser sur la vente d’Alstom à General Electric ; aux propos en écho de quelques-uns de mes clients qui me disent aujourd’hui ne plus vouloir aller aux États-Unis, même en vacances, de peur d’être mis en prison pour de mauvaises raisons, le temps de leur faire renoncer à un contrat ou de leur faire suffisamment peur pour qu’ils renoncent à un marché ; aux milliards d’amendes imposées aux sociétés européennes par le Trésor américain, comme un shérif fabriquant de faux dalton partout dans le monde pour mieux servir les intérêts des riches propriétaires locaux. Où est passé Clint Eastwood, prophète justicier des pères fondateurs de la démocratie américaine ? Les États-Unis pour les autres pays sont-ils en passe de devenir un pays « illibéral » comme la Hongrie d’Orban qui en a inventé le terme ?
Je pense à ces grands artistes, ces grands écrivains, intellectuels américains qui tirent la sonnette d’alarme, à la crainte qui s’installe jour après jour de voir les États-Unis faire une embardée de trop, ou le fameux « I apologize » ne sera plus suffisant.
Je vois la dureté s’installer un peu partout pour défendre le seul dieu qui vaille : le consumérisme et la réussite monétaire… Si tu n’as pas tu n’es pas. Looser ou winner… Et les couleurs des grands westerns devenir un peu vieillottes, délavées.
Comment est-il possible qu’un aussi grand pays ait pu élire un président comme Donald Trump, qui dit attraper les femmes par la chatte, qui est d’une inculture crasse, qui prétend que la guerre d’indépendance a été gagnée grâce à l’aviation, parle récemment de Toledo au lieu de El Paso, insulte mon président comme tant d’autres personnes d’ailleurs, érige la bouffonnerie et la menace en mode de gouvernement ostensible. Un Donald qui ressemble à un Mickey. Pour se rassurer, on cherche des circonstances atténuantes à Trump pour minimiser sa dinguerie (lisez les Narcisse de marie France Hirigoyen, c’est un ouvrage sérieux), on se dit que la parole décomplexée permet d’éviter des actes décomplexés et qu’il s’agit simplement de rodomontades pour « faire genre », que c’est purement électoral mais que la grande démocratie américaine a mis suffisamment de gardes fous en place pour éviter la connerie de trop. Mais chaque mois rajoute son lot de propos qui font frémir : il veut acheter le Groenland comme on s’offre une voiture, pourquoi pas la Côte d’Azur ; il met en place la détention illimitée des enfants d’immigrés, veut permettre le licenciement des transgenres (avant quoi ? Le gaz comme certaines minorités et les homosexuels par les nazis avant-guerre ?). Si de tels actes étaient effectués par un dictateur, que dirait le monde ? Jusqu’où ?
Comment est-ce possible ? A-t-on touché le fond ? Les peuples ont-ils retouché le fond ? Trump est le reflet d’un Américain sur deux… N’a-t-on pas exagéré le rêve américain ? S’est-il seulement réalisé pour ces 50 % d’Américains qui ont voté pour lui ? A-t-il jamais pénétré au fin fond des campagnes et bourgades américaines ? A force de vouloir imposer l’american way of life partout dans le monde, les Etats-Unis ont suscité plus de rejet que d’adhésion. Mais sans apprendre du passé pour corriger le tir, on en rajoute des pelletés, renforçant encore plus le rejet et désolidarisant ses amis de toujours, qui se pincent le nez pour le moment mais ne pourront plus respirer demain si cela continue, contraints à trouver un peu d’air ailleurs.
Trump, comme beaucoup de leaders politiques actuels, laboure sur le rejet des élites et ces mêmes élites ne comprennent toujours pas ce qui se passe et pourquoi cela tourne mal un peu partout, des « déplorables » d’Hillary Clinton aux « sans Dents » de François hollande. Christopher Lasch dans « la révolte des élites » publié en 1994, avait déjà – et de manière prophétique – stigmatisé la trahison des élites, vivant d’une manière inaccessible pour l’ensemble des peuples, instaurant comme seuls marqueurs de ce qui compte, la réussite sociale et l’argent. Et c’est peut-être, après l’échec du communisme, l’échec du libéralisme qui se profile, dont on a surestimé le triomphe définitif lors de la chute du Mur de Berlin, oubliant qu’il faut sans cesse remette le chantier à l’ouvrage. Le libre échange a amélioré la richesse des pays mais aussi les frustrations puissance cube de ne pas avoir ; et créé « un entre soi » des plus successful qui ne se soucient plus guère des populations du milieu, les loosers du libéralisme, comme le dit Lasch.
Toutefois, « avoir » uniquement ne structure pas une société. L’élection de Trump et des autres illibéraux dans le monde pointe l’inquiétude des peuples qui s’offrent, comme toujours, aux grandes gueules.
De quoi seront faites les prochaines années ? Faut-il désormais être dingue, psychologiquement atteint, un clown, pour pouvoir être élu et gouverner nos pays ? Que vaut un dirigeant prêt à tous les stratagèmes et renoncements pour être élu ? Que vaut un Président qui attise les divisions, les clivages entre les gens, ment ouvertement, pratique le rapport de force et la menace de manière permanente plutôt que de favoriser l’adhésion, montre du doigt et désigne des boucs émissaires en écho au vide politique de sa pensée ? Un dirigeant digne de ce nom se doit d’éduquer, d’élever son peuple, pas d’en flatter les plus vils instincts qui flottent toujours dans les marécages de la peur et de l’inculture.
Quand j’étais étudiant, on m’a rabâché que nos aîné avaient été bien stupides en laissant se développer un terreau qui a provoqué deux guerres mondiales. Mais comment nos propres ainés jugeront notre partie d’histoire ? Ce que nous avons laissé s’installer, alors que les trente glorieuses nous avaient donné des moyens historiquement extraordinaires pour réussir la transition du siècle, du millénaire. Finalement, la génération de la libération sexuelle, de la révolte étudiante, des beaux principes, n’a-t-elle pas trop eu pour centre du monde son propre nombril, incapable de fabriquer autre chose qu’un monde qui recherche la satisfaction immédiate et jouissive, trépigne et tape des pieds quand cela ne marche pas comme voulu, incapable de recentrer sa vision sur une construction plus globale qui la dépasse ? Héritier du passé, faussement avant-gardiste, pas vraiment dans le XXIème siècle mais ayant profité du meilleur du XXème siècle et se raidissant pour ne pas perdre ses dernières illusions de confort à vie.
Alors je suis triste et inquiet, je m’interroge : que reste-t-il du rêve américain, en tout cas de ce rêve américain qui était venu jusqu’à moi ? Le libéralisme économique à outrance n’est-il pas un mauvais western qui va finir mal ? Peut-on abuser de la doxa libérale à ce point ? Un modèle peut-il durer sans provoquer son propre effondrement ? Y aura-t-il un nouveau Clint Eastwood pour sauver la démocratie de Tocqueville car à n’en pas douter, la trajectoire actuelle questionne nos principes démocratiques.
Les valeurs partagées dans le passé seront elles plus fortes que les violations répétées des droits les plus élémentaires ? Que se passerait-il si demain les États-Unis nous demandaient de les suivre dans un mauvais choix historique et guerrier, en nous rappelant les plages du débarquement de 1944, le passé historique qui nous lie, pour seule justification de notre adhésion ? Le passé serait-il une bonne excuse pour être du mauvais côté de l’histoire si cela se produisait ? Je pense au discours de Dominique de Villepin à l’ONU le 14 février 2003 : « et c’est un vieux pays la France, d’un vieux continent comme le mien… ».
« La violence est l’un des principes fondateurs des États-Unis », déclarait T.C Boyle récemment. Le temps du western n’est toujours pas bien loin. Mais les héros des films de mon enfance faisaient triompher d’autres valeurs. Des valeurs, des personnalités, qui ont fait de moi un américanophile farouche, mais jusqu’à quand ? Je crois portant aux ressources infinies de l’intelligence, à tout ce qui se passe d’ébouriffant outre-Atlantique et aux hommes et femmes qui ne veulent pas se Trumper d’histoire.
Les États-Unis sont toujours admirés et il ne manque pourtant pas grand-chose pour enchanter de nouveau le monde. Juste la volonté d’écrire l’histoire avec bon sens. Comme le disait une diseuse de bonne aventure à Maurizio Cattelan : « quand tu doutes, réalise un western ». Je pense qu’il est temps.
Make America great again ? Sincerement « I have a dream ».
Philippe Rosenpick