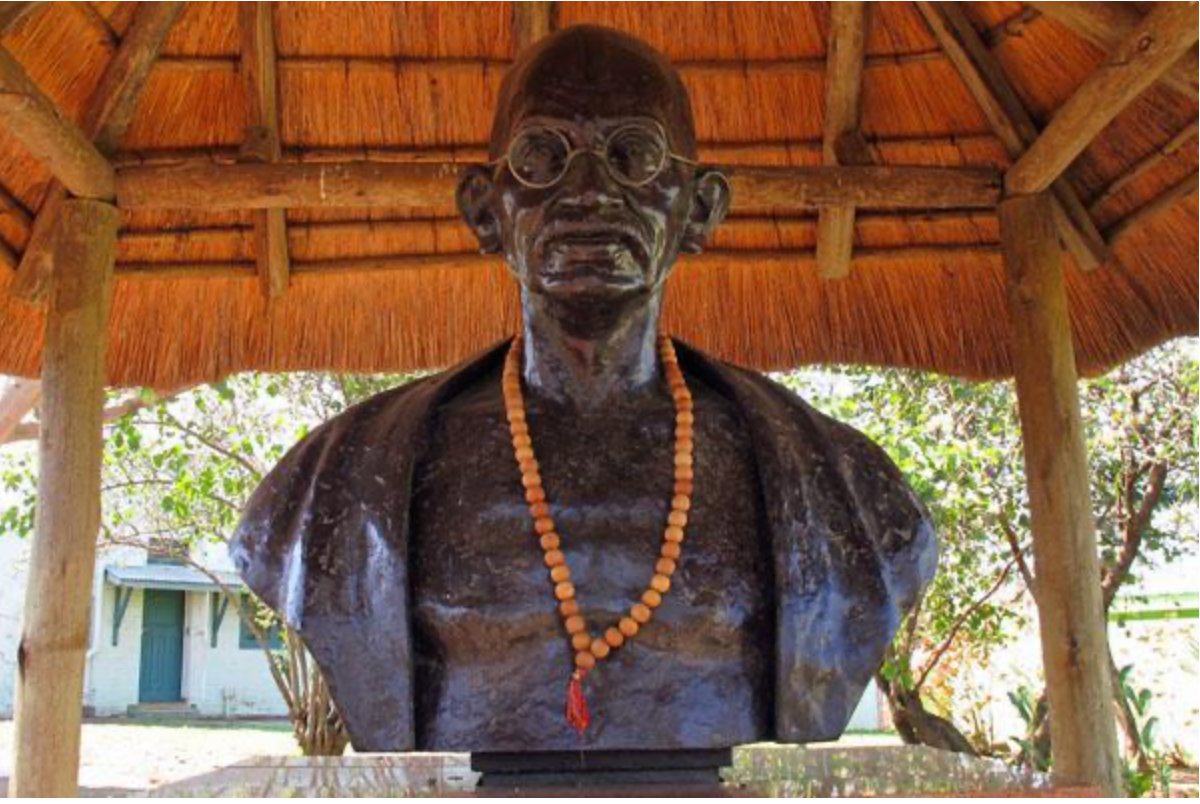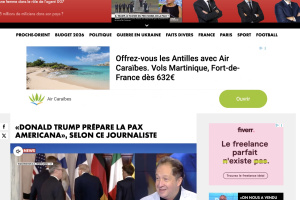Depuis quelques années, l’Afrique de l’Ouest est confrontée à une série de coups d’Etat militaires. Le Burkina Faso, la Guinée et le Mali sont désormais dirigés par des juntes qui ont confisqué le pouvoir politique, reportant à de longs mois voire plusieurs années un retour à l’ordre constitutionnel. Organisation regroupant quinze pays de la région, la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) y envoie régulièrement des missions d’experts dans le but de maintenir un dialogue, afin d’éviter une captation de la gestion des affaires par les militaires, dont le rôle devrait plutôt être de défendre les frontières d’un Etat et non pas de le diriger.
Quel bilan peut-on faire aujourd’hui de ces actions ?
Retour en trois volets sur une succession de sommets et de communiqués provoqués par les crises au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Face à ces trois pays, la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la Cedeao s’apparente à un club de dirigeants promouvant la bonne gouvernance, mais totalement impuissants ou trop frileux à faire valoir leur vision sur le terrain dans la gestion des conflits. Une situation qui pourrait devenir encore plus problématique si un autre Etat membre était à son tour prochainement victime d’un coup d’Etat militaire.
Mali : de mal en pis…
Certes les démocraties ne sont pas parfaites, tant s’en faut, mais au moins, même les plus autoritaires permettent d’intégrer une critique de leur action. En revanche, avec les militaires au pouvoir, tout cela disparaît. Avec le coup d’Etat du 18 mai 2020, visant le renversement du président Ibrahim Boubacar Keïta, au Mali, l’Afrique de l’Ouest a renoué avec une pratique que l’on espérait d’autre temps. Les putschistes avaient – le croyait-on – disparu du paysage ouest-africain depuis septembre 2015 et la tentative ratée de Gilbert Diendéré d’empêcher un renouveau démocratique au Burkina Faso.
A l’époque, le « pays des hommes intègres » tente de suivre une transition politique sous la conduite du président Michel Kafando et de son Premier ministre, le lieutenant-colonel Isaac Zida. Mais le matin du 17 septembre 2015, les Burkinabè apprennent, par leurs écrans de la télévision nationale, la dissolution des institutions suite à un coup de force du Régiment de sécurité présidentielle (RSP). Le lieutenant-colonel Mamadou Bamba, au nom d’un « comité de soldats », indique que le président de la transition est « démis de ses fonctions », que le gouvernement et le Conseil national de la transition sont « dissous ». Des mesures intervenant après avoir brutalement interrompu le Conseil des ministres pour arrêter Michel Kafando et Isaac Zida.
Dans la foulée de ces annonces, sous la présidence de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), les pays et organisations membres du Groupe international de soutien et d’accompagnement à la transition au Burkina Faso (Gisat-BF) condamnent « avec la plus grande fermeté le coup d’Etat perpétré par des éléments des forces de défense et de sécurité burkinabè ». Ils rappellent également une « tolérance zéro aux prises de pouvoir par la force » et rejettent « l’interruption du processus démocratique ».
Cette déclaration de principe s’accompagne d’une mise en garde envers les auteurs du putsch, qui « seront tenus responsables de leurs actes et de toutes les conséquences de ce coup de force ». Des condamnations se font également entendre du côté des Nations unies, de l’Union africaine, de l’Union européenne, de la France et des Etats-Unis.
Le lendemain, il apparaît en fait que l’homme fort du putsch est le général Gilbert Diendéré, l’un des piliers de l’ancien régime en tant que chef d’état-major particulier du président Blaise Compaoré, renversé en octobre 2014 par un mouvement populaire, après vingt-sept ans de présence à la tête de l’Etat. Devant les menaces de la communauté internationale – l’Union africaine qualifie le coup d’Etat au Burkina Faso de « terroriste », les membres de la junte sont interdits de voyager et leurs avoirs gelés – le tout-puissant patron du RSP tente de négocier. « Nous n’avons pas l’intention de nous éterniser, ni de rester », déclare-t-il à la presse internationale.
Le 20 septembre 2015, le président en exercice de la Cedeao, le Sénégalais Macky Sall, qui a fait le déplacement de Ouagadougou afin de rencontrer le général Gilbert Diendéré, annonce un « projet d’accord politique ». L’objectif : le départ des putschistes du pouvoir. Mais également le retrait du lieutenant-colonel Isaac Zida de la primature et, surtout, l’adoption d’une loi d’amnistie pour les militaires impliquées dans le coup d’Etat. Ceux-ci obtiennent également que les candidats à la présidentielle qui avaient soutenu Blaise Compaoré pourront participer au futur scrutin et que la dissolution du RSP sera laissée à l’appréciation des futures autorités élues.
« Ce sont des propositions honteuses. Ils ont cédé à toutes les demandes des putschistes. La Cedeao a payé la rançon de la prise d’otages. J’ai honte pour la Cedeao. Nous allons résister », dénonce alors Guy-Hervé Kam, porte-parole du Balai Citoyen, un mouvement de la société civile, très actif dans le renversement de Blaise Compaoré.
Finalement, la résolution de la situation va venir de l’armée burkinabè elle-même. Des unités hostiles à la junte convergent vers la capitale depuis la province. Le président Michel Kafando est exfiltré par des soldats français de la villa où il était tenu sous surveillance. Le général Gilbert Diendéré réitère sa déclaration de quitter le pouvoir au plus vite. Il promet aussi de « remettre le pouvoir aux autorités civiles de transition à l’issue de l’accord définitif de sortie de crise sous l’égide de la Cedeao ».
Le 22 septembre 2022, l’armée burkinabè et les putschistes signent un accord, sous les auspices du Mogho Naba, le roi des Mosse, qui met fin à la tentative de coup d’Etat. Ces derniers acceptent de retourner dans leurs casernes et Michel Kafando est rétabli dans ses fonctions dès le lendemain, en présence des chefs d’Etat du Bénin, du Ghana, du Niger, et du vice-président du Nigeria.
Bilan pour la Cedeao. Les propositions de l’accord obtenu par la médiation de Macky Sall ont fait l’unanimité contre elles, particulièrement de la part de la rue burkinabè – qui a dénoncé « le coup d’Etat le plus bête du monde » – et des responsables politiques locaux. Néanmoins, dans la capitale fédérale nigériane, Abuja, les chefs d’Etat et de gouvernement de l’organisation réunis en sommet extraordinaire se réjouissent « des efforts de médiation assidûment déployés par Macky Sall (…) et Thomas Boni Yayi, (…) facilitateur désigné de la Cedeao ». Ils profitent de cet auto-satisfecit pour entériner la restauration des institutions de transition. La Conférence lance aussi un appel « à toutes les parties prenantes afin qu’elles préservent la paix sociale et tiennent compte de l’intérêt supérieur de la nation ».
Il faut donc attendre cinq ans pour voir à nouveau les militaires intervenir dans la vie politique d’un Etat membre de la Cedeao. Le 18 août 2020, un coup d’Etat survient à Bamako. Son objectif : mettre un terme à la présidence d’Ibrahim Boubacar Keïta (IBK), au pouvoir depuis le 4 septembre 2013 et réélu le 12 août 2018.
Etonnamment, c’est le président déchu qui annonce lui-même sa démission de toutes ses fonctions, ainsi que la dissolution de l’Assemblée Nationale et du gouvernement de Boubou Cissé. Il est vrai que suite à son arrestation, il a été conduit sous bonne garde au camp de Kati d’où est partie la mutinerie. Les militaires, eux, s’expriment un peu plus tard par la voix du colonel-major Ismaël Wagué. Le chef d’état-major adjoint de l’armée de l’air promet une « transition politique civile afin d’organiser dans des délais raisonnables des élections générales pour permettre au Mali de se doter d’institutions fortes ».
Le putsch militaire semble même recueillir l’assentiment de la rue bamakoise. Des cris de joie sont entendus à l’annonce de la démission d’IBK, provenant sans doute de ces milliers de Maliens qui, depuis juin 2020, manifestaient régulièrement contre sa présidence, l’accusant de ne pas exercer le pouvoir, mais seulement d’en jouir.
Fidèle à son opposition à « tout changement politique anticonstitutionnel », la Cedeao, suite à un sommet extraordinaire tenu en vidéoconférence en raison de la pandémie de COVID-19, dénie « toute forme de légitimité aux putschistes », décidant la fermeture de toutes les frontières terrestres et aériennes, ainsi que l’arrêt de tous les flux et transactions économiques, commerciales et financières entre les pays membres de la Cedeao et le Mali ».
Le 19 août 2020, le théâtre d’ombres lève son rideau. L’homme fort de Bamako est désormais le colonel Assimi Goïta. Il se présente comme le président du Comité national pour le salut du peuple (CNSP). Le lendemain, la Cedeao constate que le coup d’Etat ressemble fortement à celui de 2012 « qui a déstabilisé le Mali et favorisé des attaques des groupes terroristes » et qui intervient moins d’une semaine après le départ de son médiateur à Bamako, le Nigérian Goodluck Ebele Jonathan, qui avait pourtant effectué trois missions au Mali pour rencontrer la quasi-totalité des acteurs politiques et de la vie civile maliens. Même constat pour la mission de bons offices de cinq présidents en exercice – Côte d’Ivoire, Ghana, Niger, Nigeria et Sénégal – qui eux aussi avaient pu s’entretenir avec IBK et tous les nombreux acteurs de la crise.
Un constat d’échec désastreux pour l’organisation, fondée en 1975, dont le pouvoir a été étendu en 1990 au maintien de la stabilité dans la région.
La Cedeao exige donc « le rétablissement immédiat du président Ibrahim Boubacar Keïta en tant que président de la République conformément aux dispositions constitutionnelles de son pays » et demande la mise en œuvre d’un ensemble de sanctions contre tous les militaires putschistes, leurs partenaires et leurs collaborateurs ».
Faisant fi de toutes ces déclarations et de la condamnation unanime de leur coup de force, les putschistes, nomment un président de la transition, en la personne de Bah N’Daw, ancien militaire, ex-ministre de la Défense, qui occupait cette fonction le 25 septembre 2020. A son côté, Moctar Ouane, ancien ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, est désigné pour occuper la primature.
Une mission de la Cedeao à Bamako, menée par le médiateur Goodluck Ebele Jonathan, du 23 au 25 septembre 2020, ne peut qu’entériner le nouveau pouvoir et l’agenda des putschistes. « La mission rappelle que la Cedeao est principalement concernée par la préservation de la démocratie constitutionnelle dans la sous-région et non par le soutien à des régimes quels qu’ils soient. » Néanmoins, elle prend acte des nominations à la présidence de la transition et à la tête du gouvernement, et annonce la levée des sanctions dès leur investiture effective.
Même situation de faits accomplis, lorsque, le 24 mai 2021, les putschistes décident de simplifier les choses à Bamako. Bah N’Daw et Moctar Ouane sont arrêtés par les militaires. Fin de la transition civile, le pouvoir est au bout du fusil. La communauté internationale et la Cedeao, en particulier, condamnent le coup d’Etat dans le coup d’Etat, réaffirment leur « soutien à la transition » et réclament la libération « immédiate et inconditionnelle » des dirigeants arrêtés.
Nouvelle mission de la Cedeao à Bamako, suivie, le 30 mai 2021, d’un sommet extraordinaire de l’organisation à Accra, au Ghana, sur la situation politique prévalant au Mali. Les participants réaffirment « la nécessité du recours à un processus démocratique pour l’accession au pouvoir », rappellent la nomination immédiate d’un « Premier ministre civil », la constitution d’un « gouvernement inclusif, pour la poursuite du programme de transition », et le maintien de la date du 27 février 2022 pour l’élection présidentielle.
Plus d’un an après, la situation n’a pas bougé dans les faits.
Le colonel Assimi Goïta est toujours au pouvoir à Bamako. Les communiqués de la Cedeao alternent entre nouvelles sanctions imposées au Mali, en raison du retard pris dans l’organisation des élections, et annonces de poursuite du « dialogue » avec les autorités de la transition sur le chronogramme de sortie de crise. Les Conférences des chefs d’Etat et de gouvernement ne peuvent que constater une « détérioration de la situation sécuritaire au Mali ». Suite au rapprochement de Bamako avec les paramilitaires russes du groupe Wagner, Paris a mis un terme à l’opération Barkhane. De son côté, la junte a indexé un « Etat occidental », accusant la France à demi-mot – d’avoir soutenu un contre-coup d’Etat raté dans la nuit du 11 au 12 mai 2022. Les insultes proférées par le Premier ministre Malien contre l’attitude de la France et de ses dirigeants, à la tribune des Nations-Unies en septembre dernier, ont résonné comme un chant lugubre et funèbre de la relation entre les deux pays.
Au Sommet d’Accra, le 3 juillet 2022, la Cedeao prenait acte « d’une nouvelle loi électorale mettant en place, entre autres, un organe unique de gestion des élections, dénommé Agence indépendante de gestion des élections (AIGE) » et « du calendrier de la transition soumis par les autorités de la transition qui donnent une durée de vingt-quatre mois à compter du 29 mars 2022 ». Et, en conséquence, lève les sanctions économiques et financières.
La Conférence rappelle aussi que « conformément aux engagements pris devant la Cedeao par les autorités de la transition et à la Charte de la transition, aucune autorité de la transition ne pourra participer aux élections devant conduire au retour à l’ordre constitutionnel ».
A voir !
Depuis, le chef de la junte malienne a reçu, le 11 octobre 2022, avec deux mois de retard, un « avant-projet de Constitution », qui devrait être soumis à référendum en mars 2023. Soit un an avant la date promise de retrait des militaires en faveur d’autorités sorties des urnes.
Eric Bazin
Chroniqueur Afriques demain d’Opinion Internationale