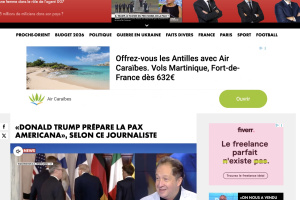| Paula Jacques : Votre premier livre, le plus célèbre, « Etre sans destin », a été mal reçu en Hongrie. Un éditeur trouvait même le manuscrit « nauséabond et antisémite ». Pourquoi ? |
| Imre Kertész : cet éditeur avait été fonctionnaire et agent secret auparavant. Pour comprendre, il faudrait se plonger dans la psychologie profonde d’un tel homme avec un passé très douloureux. Plus généralement, en Hongrie, comme face à tout problème très sérieux, on faisait comme si cela n’existait pas. La Hongrie avait cette image d’elle-même comme un pays joyeux, gai, sans ombres. Rien ne devait altérer cette image.
PJ : on dit des romanciers que l’œuvre jaillit du cœur de l’enfance. Votre contexte familial a-t-il influé sur votre destin d’écrivain, au-delà des camps de concentration ? IK : rien dans mon enfance ne m’y a prédisposé. Ma famille faisait partie de la petite bourgeoisie juive, nous vivions sous le régime très consensuel de Miklós Horthy*. Ma famille était apolitique. Lorsque je suis arrivé à Auschwitz, je n’en n’avais jamais entendu parler. Nous mettions les horreurs de la guerre, dont nous avions écho, sur le compte de la « propagande anglaise ». Les Hongrois pensaient qu’ils ne pouvaient pas être atteints par ce qui se passait, car ils étaient persuadés que Horthy allait les protéger, la Hongrie n’étant pas occupée par l’Allemagne. PJ : avez-vous lu le livre de Primo Levi « Si c’est un homme » lorsqu’il a été publié en 1947 ? IK : non, et je ne le connaissais même pas. J’ai regretté ensuite cette méconnaissance. Ceci dit, mon écriture est plus distanciée que celle de Primo Levi. Je n’écris pas sur la Shoah mais sur le fait d’avoir été privé du statut d’être humain. Lors du procès d’Adolf Eichmann (dont les Hongrois ignoraient tout), Hannah Arendt écrivit sur « la banalité du mal ». Ce livre est un peu aussi mon sujet. |
|
« Aujourd’hui on ne peut plus écrire
|
PJ : vous racontez le jour où, alors que vous étiez un jeune en train de mourir de faim dans le camp, épuisé, vous avez aperçu un rayon de soleil et un vol d’oiseau. Vous qualifiez cela de « bonheur possible » dans les camps. Est-ce par humour ou un sentiment réel ? IK : Il y a trois points de vue sur les camps dans la littérature. Celui de Primo Levi qui décrit l’horreur. Celui de Tadeusz Borowski (1922–1951), le célèbre écrivain et journaliste polonais, qui se place dans une temporalité immédiate du récit, sur le moment. Et il y a la position de Hans Mayer, alias Jean Améry (1912 – 1978), écrivain et essayiste autrichien, qui considère les conséquences, la suite, l’après. Ces trois stades requièrent trois styles d’écriture différents. PJ : et votre écriture ? IK : mon livre n’a pas pour sujet l’Holocauste, il porte sur le fait d’être sans destin. Aujourd’hui on ne peut plus écrire comme si Auschwitz n’avait pas existé. PJ : vous utilisez beaucoup l’humour dans vos livres, est-ce un outil de distanciation par rapport à ce que vous avez vécu, de répondre à ce monde qui a essayé de vous détruire ? IK : l’humour sert à distancier les choses, on ne peut pas imaginer un bon livre sans humour. PJ : vous utilisez aussi l’absurde. IK : l’humour en soit n’est pas suffisant, l’humour noir s’ajoute à l’absurdité. Plonger le lecteur dans l’horreur réelle du récit, l’y amener jusqu’à la dernière ligne, c’est l’horreur. On peut dire qu’Auschwitz est l’absurdité, mais notre vie aussi est l’absurdité même. En fait, Auschwitz a imprimé sur notre vie une ombre et on ne peut pas en voir un seul aspect sans Auschwitz. Auschwitz inventa une mécanique morbide de collaboration entre bourreau et victime, dans laquelle il est difficile de comprendre clairement le rôle des victimes. Auschwitz est une absurdité qu’on ne doit pas oublier car ce serait ça l’horreur. PJ : le terme « collaboration » est assez difficile à entendre mais ne voulez-vous pas dire que le génocide n’aurait pas si bien fonctionné sans cette « collaboration » des victimes avec leurs bourreaux ? IK : non, ce n’est pas exactement ce que je voulais dire. Quand nous sommes dans une situation où la seule façon de vivre jusqu’au lendemain est de suivre les règles qu’on nous a imposées, c’est une forme de « collaboration ». On ressent une gêne, une honte. La honte d’avoir survécu. La même chose s’est produite avec le goulag. Les juifs n’en furent pas les seules victimes. PJ : dans votre livre « Etre sans destin », vous évoquez votre retour à Budapest, vous aviez 15 ans et étiez le seul survivant de votre famille. Vous sentiez-vous coupable d’avoir survécu ? IK : En fait, la personne du roman n’est pas tout à fait moi. Quand j’ai écrit mon livre, j’en ai parlé comme un ancien combattant qui revient sur ce qu’il a vécu. Je n’étais pas conscient de ce que j’avais vécu. Il m’a fallu des années pour en prendre conscience. PJ : quand avez-vous senti que vous deviendriez écrivain ? Est-ce qu’il n’y a pas eu comme un dédoublement entre vous qui écriviez des opérettes après-guerre pour survivre, et le rescapé d’Auschwitz ? IK : vous avez raison de poser cette question de dédoublement, je ne sais pas comment j’en suis arrivé à devenir journaliste. J’étais alors en Hongrie et nous faisions face à la période d’inflation la plus dure de toute l’Europe. Dans les cafés, les convives payaient avec des brisures d’or et le serveur avait une balance pour peser l’or. PJ : dans « L’Holocauste comme culture » vous dîtes que le communisme vous a sauvé du traumatisme d’Auschwitz. IK : oui, quand on a connu deux totalitarismes, on commence à reconnaître quels en sont les prémices. Un jour vous allez à l’usine et le lendemain, on vous dit que vous ne pouvez pas entrer. Avec Auschwitz, j’étais déjà bien entraîné. Sous le régime communiste, il fallait se sauver et j’ai pensé qu’il fallait peut-être se réfugier dans l’art. Contrairement à Auschwitz, la souffrance n’est pas arrivée tout de suite pendant le communisme, mais le seul fait de sentir que cela pouvait arriver suffisait. Le totalitarisme crée des situations inhumaines auxquelles il faut faire face. |
| PJ : on associe souvent, de façon assez radicale, nazisme et communisme, vous avez tout à l’heure évoqué les goulags et Auschwitz. Est-ce la même chose ?
IK : non, le goulag et Auschwitz ce n’est pas pareil mais ils ont utilisé les mêmes méthodes. Les communistes appliquaient les mêmes méthodes que les nazis, et dès 1917, il y avait déjà des camps de travail en Russie qu’ont ensuite utilisés les nazis. Après avoir survécu à tout ça, Auschwitz et le communisme, l’essentiel était qu’il fallait survivre. En Hongrie, le goulag est resté en arrière-plan pendant toutes ces années alors qu’Auschwitz occupait le premier plan car ce dernier a laissé des traces dans notre culture judéo-chrétienne. Le scénario classique qui occupe l’esprit des Hongrois, c’est que les gens vivaient heureux puis les nazis les ont emmenés à Auschwitz, puis les Américains et les Russes les ont libérés et ils sont rentrés chez eux et ont vécu heureux jusqu’à la fin de leur vie. C’est cette vision qui domine en Hongrie. C’est la même aux Etats-Unis et partout en Europe. Regardez le film « La liste de Schindler » (1993) de Steven Spielberg (inspiré du roman éponyme de Thomas Keneally) : la fin est heureuse, c’est la victoire. Dans le film « La vie est belle » (1997) de Roberto Benigni, à la fin, l’enfant monte sur le char et crie « Victoire » alors qu’on comprend que son père est mort. |
|
Qu’aurais-je fait sans Camus ?
|
PJ : Y a-t-il un destin européen de la littérature ? IK : Qu’aurais-je je fait sans Camus ? L’art européen n’est pas que décoratif mais toujours très proche de l’histoire pour quelle puisse donner quelque espoir métaphysique aux Européens. Cet art doit être libre et courageux. Les œuvres européennes sont comme les peintures de Rembrandt : elle traquent la lumière au fond de l’obscurité. Avec mon œuvre, j’ai commence par entrouvrir les portes de l’obscurité. Et il faut certainement avoir été victime de l’obscurantisme pour partager cette expérience métaphysique avec le lecteur. PJ : avez-vous d’autres jouissances dans la vie que l’écriture ? IK : évidemment, on n’est pas aveugle à l’amour, à la vie conjugale, à la beauté, aux voyages. On peut aussi être heureux d’avoir écrit une belle phrase. PJ : n’a-t-on pas aussi cette envie de rattraper ce qu’on vous a pris et de profiter au maximum de tout ? IK : ô vous savez, pour qu’après Auschwitz on devienne écrivain, il faut avoir éprouvé une très grande joie de vivre. Le jeune couple chez Goethe se tue par bonheur de la vie. Quand on sort des camps de la mort, on a envie de vivre pleinement et un de ces plaisirs, c’est l’écriture. Si je parlais d’une façon extrémiste, je dirais que d’une certaine façon, j’ai eu la chance de vivre une des situations les plus extrêmes. Si je l’étais encore plus, je dirais qu’il n’y a pas de meilleur sujet pour un roman. D’autant qu’on ne peut plus imaginer la réalité d’Auschwitz. PJ : vous avez dit que tant qu’on a un livre à écrire, on ne peut pas mourir. Où en êtes-vous ? IK : j’ai des projets pour mon livre et pour ma mort, les deux font la course. C’est une course entre Parkinson et le livre. |
| Propos recueillis par Céline Garcia |
 Être sans destin (Sorstalanság), 1975 – Actes Sud, 1998 Être sans destin (Sorstalanság), 1975 – Actes Sud, 1998Imre Kertész a reçu le 5 mai la Grande Médaille Vermeil des mains de Bertrand Delanoë, Maire de Paris. |
Solutions pour la France

France : faut-il une Cour suprême à l’américaine ? Solutions pour la France
Opinion India

Inde : Sommet avec l’Union européenne, Fête nationale et carrefour géopolitique. L’édito de Michel Taube
Abraham XXI

Dubaï, point d’orgue d’une année 2024 flamboyante avec le Concerto pour la paix d’Omar Harfouch en présence d’Orlando Bloom
IRAN C'est une révolution!

Iran : une répression d’une ampleur sans précédent sous blackout numérique. Journal de bord de Mina Rad
Opinion Amériques Latines

Venezuela : il faut offrir une porte de sortie au dictateur Maduro. La chronique de Laurent Tranier
Les Unes d'Opinion Internationale