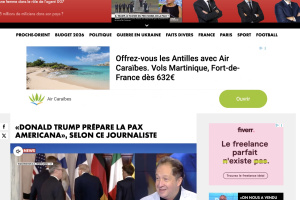Le mardi 1er Avril, 80 camions surchargés attendent le signal du départ : une escorte de la MISCA ou de Sangaris doit quitter le quartier Kilomètre 5 de Bangui pour un exode probablement sans retour. Dans ce quartier musulman, où les habitants « prisonniers » de leur propre ville, n’osent plus s’aventurer dans les quartiers avoisinants par peur que les « les chrétiens les tuent », un grand nombre a opté pour l’exil vers le nord et l’est du pays. En écho, des populations chrétiennes sont entassées dans des conditions extrêmement précaires, notamment dans des camps de déplacés qui longent la piste d’atterrissage de l’aéroport international de Bangui. Tant que leur sécurité n’est pas assurée, ils refusent de rentrer dans leurs quartiers craignant d’être « tués par les musulmans ».
Le marqueur religieux n’a jamais été déterminant en RCA
L’idée s’est imposée aussi brusquement que récemment, non seulement dans les médias nationaux et internationaux, mais aussi dans les discours de ceux-là mêmes qui souffrent le plus de la situation, que la crise centrafricaine serait un conflit intercommunautaire entre musulmans et chrétiens. Or cette confrontation confessionnelle est bien plus une conséquence de la crise actuelle qu’une de ses causes. Le drame est que les discours de certains dirigeants centrafricains ont fini par produire ce qu’ils énoncent. Cette rivalité prospère, certes, sur certains fondements historiques et sociologiques, mais elle est surtout due à l’action récente de groupes armés et des responsables politiques qui ont instrumentalisé les appartenances religieuses.
Les croyances religieuses en Centrafrique se répartissent en trois groupes principaux – chrétiens, musulmans et animistes – mais les estimations sur leur répartition divergent. Les chiffres officiels donnent 80% de chrétiens, 12% de musulmans et 8% d’animistes. L’ONU, en revanche, évalue la répartition à 50% de chrétiens, 15% de musulmans et 35% d’animistes. Au-delà des chiffres, Maria Malagardis, dans un article du quotidien Libération, rappelle la boutade qui a cours dans la capitale, Bangui : « En Centrafrique, il y a 70% de chrétiens, 30% de musulmans et 100% d’animistes ». Elle souligne la réalité d’un pays où les religions « importées » jouent avant tout un rôle de vernis social. Les mariages entre personnes des deux confessions sont fréquents et nombreux sont les Centrafricains d’une confession à avoir un parent de l’autre. Les populations ont toujours vécu, jusqu’à récemment du moins, mélangées dans les mêmes quartiers et les mêmes villages. La question de l’identité religieuse des uns ou des autres ne se posait pas.
Des conditions politiques et sociales
La Centrafrique est en effet un pays où le marqueur religieux n’a jamais été déterminant. Si des sources de tensions et de compétition existent, elles sont avant tout d’ordre sociologique et historique. Dans un article éclairant des Etudes Géostratégiques « Centrafrique : La fabrication d’un « choc des civilisations » ? », Patrice Gourdin décrit comment, dans un pays dont l’économie reste principalement fondée sur l’agriculture, les modes de vie se répartissent entre agriculteurs, pêcheurs, chasseurs ou commerçants sédentaires et pasteurs ou marchands nomades. La plupart des communautés sont ainsi spécialisées dans certaines activités : une ethnie est associée à une activité particulière qui s’accompagne de conditions économiques, d’un niveau d’éducation et d’un degré d’intégration politique. Patrice Gourdin observe que « ces facteurs génèrent autant de complémentarités suscitant des rapprochements, que de tensions susceptibles de dégénérer en affrontements. » Mais il insiste surtout : « l’appartenance religieuse ne semble ni prégnante ni déterminante. »
Une donnée géopolitique interne est venue se greffer sur ces données sociologiques : le nord-est du pays est à ce titre révélateur. S’inscrivant naturellement dans la zone d’influence du Tchad et du sud du Darfour, il a toujours été tenu à l’écart par le gouvernement central qui n’a réalisé que très peu d’efforts en termes d’administration et d’infrastructures. Bokassa en avait même fait une zone d’exil intérieur en y déportant ses opposants dans un camp de travail forcé situé vers Birao.
Or, ce sont précisément de ces régions que proviennent les Séléka, là où les musulmans sont majoritaires. Quand en août 2012, plusieurs groupes se fédèrent au sein de la Séléka – Union en sango – pour chasser le président François Bozizé alors au pouvoir depuis 2003, ils obtiennent des succès militaires fulgurants face aux Forces Armées Centrafricaines (FACA). Arrivés dans la capitale, les Séléka se révèlent rapidement incontrôlables. Ils commettent de multiples exactions, des violences et des pillages à répétition contre la population. A tel point que Michel Djotodia, chef rebelle ayant pris la place de François Bozizé, dissout en septembre 2013 la Séléka qui n’avait pourtant aucune existence légale.
Séléka et anti-balaka, synonymes de musulmans et de chrétiens
Le tour confessionnel que va prendre le conflit se développe alors dans un contexte profondément confus. D’une part, la population perçoit les exactions commises par les Séléka comme visant spécifiquement les chrétiens et comme épargnant systématiquement les musulmans. Dans la confusion, personne ne sait en réalité qui est rebelle ou simple voyou armé. Certains semblent avoir profité de la situation et pris prétexte de la religion pour attaquer des chrétiens dans le seul but de les piller. La plupart des Séléka seront ensuite cantonnés mais rarement désarmés. Beaucoup « occupent » la partie nord-est de la Centrafrique et font craindre des velléités de partition du pays.
D’autre part, des discours réducteurs associent la Séléka à des musulmans, voire à des radicaux islamistes. A titre d’exemple, un article paru dans le quotidien Le Monde, daté du 1er janvier 2013, intitulé « A Bangui, les pro-Bozizé accusent les ‘Tchadiens’ » reprend les déclarations du ministre de l’administration du territoire, Josué Binoua. Alors que François Bozizé est encore au pouvoir, Binoua, pasteur et porte-parole du front antirébellion du président, assurait que « les rebelles [étaient] équipés par les wahhabites et qu’ils [voulaient] faire de la Centrafrique un autre Mali ».
Pourtant, si la rébellion Séléka est constituée de groupes essentiellement venus de régions où les musulmans sont majoritaires, elle est non seulement rejointe par des opposants politiques parmi lesquels on trouve d’anciens membres de gouvernement et des militants des droits de l’homme, mais elle est aussi constituée de chrétiens, même s’il est difficile d’évaluer leur proportion (certains observateurs évoquent un chiffre allant jusqu’à 30%).
L’entrée en scène de milices d’autodéfense ne fait que rajouter à la tension et à la confusion et achève de donner au conflit sa logique confessionnelle. Le 23 décembre 2012, presque un an avant la dissolution de la Séléka, alors qu’il est encore au pouvoir, l’ex-président François Bozizé appelle les jeunes désœuvrés des quartiers périphériques de Bangui à former des milices d’autodéfense pour empêcher l’infiltration des rebelles Séléka dans la ville. Les « anti-balakas » (dont on ne sait s’ils sont des « anti-machettes », balaka voulant dire machette en Sango, ou des « anti-balles AK47 ») se revendiquent comme des groupes d’autodéfense et réagissent violemment aux Sélékas dans tout le pays.
Si les médias leur accolent systématiquement l’adjectif chrétien et évoquent des « milices chrétiennes anti-balaka », de nombreux observateurs font remarquer qu’il ne traduit en rien la réalité. S’il y a des chrétiens parmi ces miliciens, tous ne le sont pas et, surtout, les milices d’autodéfense ne sont que l’amplification d’un phénomène né il y a plus d’une vingtaine d’années face à l’absence récurrente de protection de la population civile de la part de l’État centrafricain.
Pour partie constitués de partisans de l’ex-président Bozizé, ces groupes correspondent aussi à un mouvement spontané qui se perçoit et s’affirme comme une « armée populaire ». Dans un article publié par Jeune Afrique, un habitant témoigne de la violence et de la logique de bouc émissaire qui prévaut désormais : les groupes d’autodéfense « ne font pas la différence entre les rebelles musulmans et les musulmans tout court. »
Seul le dialogue peut contrer les constructions idéologiques
Aujourd’hui, le cycle de violence et de représailles entre ex-Séléka et anti-balakas a, de fait, plongé le conflit centrafricain dans une dimension communautaire. Mais, les événements, aussi confus soient-ils, démontrent que ce sont les dimensions politiques et sociales qui ont abouti à l’instrumentalisation de caractéristiques sociologiques qui n’avaient jamais suscité d’affrontement majeur auparavant. Le conflit a ainsi donné aux discours de certains responsables politiques leur qualité tristement auto-réalisatrice. Pourtant les victimes du conflit, qui appartiennent – il faut le rappeler et le souligner – majoritairement à la population civile, réclament, avant tout et pour la plupart, l’apaisement et le retour à des conditions de vie normales.
Ravivant l’inévitable débat entre paix et justice dans les situations de post-conflit, certains réclament légitimement que justice soit faite, posant cette condition comme préalable à toute réconciliation. Pourtant, l’Etat centrafricain est exsangue, la chaîne pénale est anéantie et le gouvernement de transition mené par Catherine Samba-Panza peine à faire face à la situation, contraint d’attendre des décisions qui se prennent en France et à New York. La mise en place d’ici septembre prochain d’une mission de paix onusienne permettra, espérons-le, de travailler en profondeur sur la résorption de la dimension artificiellement confessionnelle de la crise.
Si la Centrafrique est confrontée aux défis de restaurer la sécurité à court terme et, à long terme, de reconstruire l’Etat, seul le dialogue entre les communautés est, aujourd’hui, susceptible de reconstituer un fragile tissu social déchiré par des constructions idéologiques. Ce sont les Centrafricains eux-mêmes – classe politique bien évidemment, mais société civile aussi et surtout – qui doivent reprendre leur destin en main.