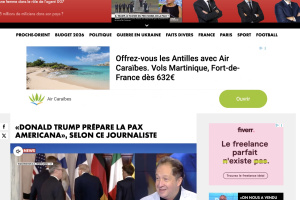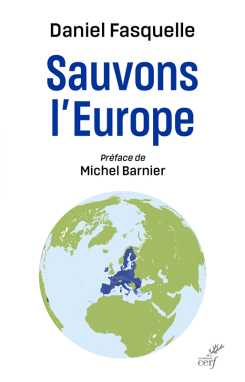 Il est une voix claire et lucide au sein de ce qu’il reste du parti Les Républicains, dont il est le trésorier. Dans son dernier essai à paraître aux Éditions du Cerf, Sauvons l’Europe (avril 2024, 168 pages, 20 €, préface de Michel Barnier), Daniel Fasquelle, ancien député, professeur de droit et maire du Touquet-Paris-Plage se pose en Européen convaincu.
Il est une voix claire et lucide au sein de ce qu’il reste du parti Les Républicains, dont il est le trésorier. Dans son dernier essai à paraître aux Éditions du Cerf, Sauvons l’Europe (avril 2024, 168 pages, 20 €, préface de Michel Barnier), Daniel Fasquelle, ancien député, professeur de droit et maire du Touquet-Paris-Plage se pose en Européen convaincu.
Loin du populisme pavlovien qui consiste à rejeter sur l’Europe ce qui ne relève que de l’inconséquence et de la veulerie des gouvernants, et parfois des attentes contradictoires de nos concitoyens, il rappelle que l’Europe est un vecteur de démocratie, de richesse et de souveraineté. Constructions humaines et donc imparfaites, les institutions européennes doivent continuer à être défendues et améliorées. Avec cette conviction : bientôt, la construction européenne sera achevée.
(…)
Pour moi, la question européenne, c’est cela : une Europe‑problème et une Europe‑solution. L’Europe problème, ce sont des nations fratricides – ou plutôt des nations asservies à des dirigeants fratricides que rien ne retient dans leur dessein funeste, pas même la mort de millions de personnes. L’Europe‑solution, ce sont les mêmes nations qui, encore traumatisées par leur long séjour aux enfers, décident de s’unir pour de bon, par des actes et non seulement par des mots, par des liens durables et non seulement par des sentiments aléatoires. L’Europe‑problème, c’est l’ignorance et le fanatisme qui se transforment en haine ; l’Europe solution, c’est le malheur vécu ensemble qui se transforme en fraternité. L’Europe‑problème, ce sont les nazis qui massacrent les Polonais et la France qui réagit trop tard ; l’Europe‑solution, ce sont les mêmes Polonais qui viennent libérer une partie du nord de la France.
Dire que « l’Europe, c’est la paix » suscite de plus en plus souvent des haussements d’épaules blasés ou des roulements d’yeux agacés. On s’habitue. On oublie. On passe de la reconnaissance affichée à l’ingratitude qui ne dit pas son nom. Et pourtant… Peut‑être les nations européennes ne seraient‑elles pas, sans la construction européenne, retombées dans leurs travers séculaires. Peut‑être. Voulons‑nous vraiment nous y risquer ? Voulons‑nous vraiment tenter le diable ? Sans même évoquer la perspective du retour de la guerre en Europe de l’Ouest – elle est déjà de retour, hélas, en Europe de l’Est – les Britanniques pourraient nous renseigner sur ce qu’il en coûte… Ils sont une majorité, c’est un fait, à regretter aujourd’hui le Brexit.
Ce que je propose dans cet ouvrage, ce n’est pas de se voiler la face en ignorant tout ce qui nous déplaît, nous énerve ou nous inquiète dans la manière dont vit et fonctionne l’Union européenne d’aujourd’hui. On connaît, à cet égard, notre relation ambiguë, et pas toujours de bonne foi, à la construction européenne : nous autres, Français, la plébiscitons en théorie mais la conspuons en pratique… Pire, nous ne l’aimons jamais tant que portée par les grands mots, les grands principes, les grandes musiques – et nous lui reprochons en même temps d’être trop lointaine, trop éthérée, de n’avoir aucun effet positif sur notre quotidien… Des idées auxquelles nous nous accrochons pourtant de manière insensée.
À rebours de ce rapport passionné, je propose de faire l’effort de reconnaître tout ce que l’Union nous a apporté, d’apprécier tout ce qu’elle nous apporte, et d’imaginer tout ce qu’elle peut nous apporter. Et de faire cet effort en tant que Français, porteurs d’un génie singulier, déterminés par une identité qui n’est pas incompatible avec l’identité européenne, qui en est au contraire un fragment original, une germination éminente. De faire cet effort, enfin, jusqu’à éprouver pour l’Europe le sentiment qu’elle mérite : une amitié raisonnable.
(…)
L’Europe, notre civilisation
(…)
Prolongeant l’analyse de Husserl et de Guizot, Marcel Gauchet affirme de son côté que la place particulière de l’Europe dans l’histoire de l’humanité et, par conséquent, la singularité de son identité, tiennent principalement au fait qu’elle est « le continent de l’invention de la modernité – politique, intellectuelle et scientifique, économique et technique », une invention, affirme‑t‑il, qui est « devenue désormais un bien commun planétaire ».
La modernité européenne
Qu’est‑ce que cette modernité européenne ?
C’est tout d’abord la centralité de la personne. La personne, c’est autre chose que l’être humain tout court. C’est l’être humain en tant que sujet de droit et être de relation – nous retrouvons dans ces deux caractéristiques l’héritage romain et l’héritage évangélique. Cette centralité, comme l’a montré l’un des pères de la sociologique, Marcel Mauss, dépend du type de société : toutes ne sont pas aptes à l’assurer. Autrement dit, la civilisation européenne renvoie à une certaine articulation entre personne et société : la civilisation européenne est cet espace‑temps, unique au monde, où l’être humain est une personne, c’est‑à‑dire qu’il est au centre de la société, de son fonctionnement, de ses structures, de la conscience qu’elle a d’elle‑même, de son passé, de son présent et de son avenir.
Paul Ricœur le dit autrement : la personne est ce qui est au cœur de l’être, au‑delà du tempérament, du caractère, de la mentalité. La personne est l’être humain en condition d’agir pleinement lui‑même, sans la contrainte de « forces anonymes ». « La personne agit et n’est pas agie », dit Ricœur. Cela fait écho à la phrase bien connue de Kant, où sont résumées, à mes yeux, deux « créations » européennes, à savoir l’humanisme et les Lumières : « L’homme, et en général tout être raisonnable, existe comme fin en soi, et non pas simplement comme moyen dont telle ou telle volonté puisse user à son gré […]. [Ainsi], agis de telle sorte que tu traites l’humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre toujours en même temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen. »
On peut élargir la focale et examiner les conséquences politiques de cette donnée. La civilisation européenne, c’est le refus de la dépendance à l’égard d’un ordre transcendant ou d’un pouvoir qui ne trouverait pas son origine, et donc sa légitimité, dans le monde des hommes. C’est la quête permanente de l’autonomie. De là découlent la conscience morale, la liberté individuelle, la subjectivité, la distinction entre domaine privé et domaine public, la séparation entre pouvoir religieux et pouvoir politique, le poids de la science, mais aussi le capitalisme, l’indépendance de la société par rapport à l’État et la croyance dans le progrès – sans oublier, évidemment, la démocratie.
Bien sûr, cette modernité d’origine européenne n’est pas plus monolithique que ne l’est l’histoire européenne, dont j’ai parlé plus haut. Parce qu’elle est en quelque sorte « l’âge de l’homme » succédant à « l’âge des dieux », et que l’homme, justement, est un sujet « divers et ondoyant » (Montaigne), la modernité est une réalité complexe, changeante, poreuse, qui semble désormais chez elle partout, et ne se laisse plus enfermer dans le cadre géographique de son émergence. La modernité n’appartient plus aux Européens et tout le monde y aspire. Et pourtant, si l’on en croit Gauchet, « la vieille Europe demeure l’épicentre de la redéfinition des structures de l’être‑ensemble qui emporte et travaille le monde en son entier ». Ainsi revient‑on à Husserl, pour qui l’Europe occupe une place à part dans l’histoire des civilisations, dans la mesure où il y a en elle « quelque chose d’un genre unique, que tous les autres groupes humains eux-mêmes ressentent chez nous, et qui est pour eux […] une incitation à s’européaniser toujours davantage ».
L’Europe pour et par la France
Je voudrais terminer ce livre par la France. Il ne suffit pas de dire qu’il n’y a pas d’Europe sans la France. C’est une évidence factuelle, géographique, historique et civilisationnelle, comme je crois l’avoir montré. Ce qu’il nous appartient désormais de comprendre et, surtout, de vivre, c’est qu’il n’y aura pas d’Europe authentique – j’aurais presque envie d’écrire : d’Europe européenne – sans la France. Et le futur que j’emploie pour exprimer cette idée est bel et bien un futur de l’indicatif : il va falloir qu’il y ait une Europe, et une Europe dont on puisse dire un jour : « Voilà, elle est achevée. » Eh bien, c’est la France qui détient la clé pour que ce jour advienne. Seule la France peut tracer le chemin d’une Europe fidèle à « ses trésors du passé et ses pressentiments d’avenir », selon la formule de Simone Weil. Tels sont sa mission et son devoir.
Mais pour cela, elle doit revenir au premier plan. La France, ce « cher vieux pays » dont parlait de Gaulle, dans toute l’épaisseur de son génie. La France elle‑même, oui, et pas seulement tel ou tel dirigeant plus énergique ou entreprenant que ses prédécesseurs. Il faut basculer d’un régime d’influence épisodique à une stratégie d’influence structurelle.
Je voudrais esquisser deux pistes permettant d’atteindre un tel objectif. La première tient aux hommes et aux femmes qui sont aux commandes de l’Union européenne. Ce qu’ont fait les Anglais hier, avant de se mettre en retrait puis de partir, ce que font les Allemands aujourd’hui, les Français doivent le faire eux aussi. Et, pour y parvenir, le décider. En apparence, dans la répartition des postes importants au sein des institutions européennes, l’équilibre règne entre les pays membres, en particulier les plus puissants, tels la France, l’Allemagne, l’Italie. Ainsi, si la présidente de la Commission est allemande, celle de la Banque centrale est française, le président du Conseil est belge et celui du Parlement est italien, quand le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité est espagnol. Mais, en réalité, quand on descend au niveau subalterne, celui des 56 directions générales et agences diverses, avec leurs directeurs généraux et directeurs généraux adjoints (soit plus de 150 personnes) les Français sont au nombre de… 11 ! Ce serait presque risible si cela ne révélait pas notre impuissance. Michel Barnier est, parmi nos compatriotes, celui qui connaît ce que notre pays devrait faire pour retrouver son influence. Pourquoi ces Français qui connaissent parfaitement les arcanes bruxellois ne sont‑ils pas mieux écoutés ?
La deuxième piste, pour restaurer l’influence française au sein de l’Union européenne, et pas seulement sur la scène mais aussi dans les coulisses, concerne le droit. J’ai expliqué, dans les pages qui précèdent, que l’Union est avant tout une communauté juridique. Le droit est donc un levier majeur. Cette deuxième piste rejoint d’ailleurs la première, dans le sens où le droit français, et la conception française du droit, influencera d’autant plus facilement le droit européen que nous aurons, aux postes adéquats, des relais capables de les promouvoir.
(…)
La stratégie d’influence structurelle que j’appelle de mes vœux implique aussi de renforcer notre diplomatie nationale à l’égard de nos partenaires, en particulier ceux de l’est du continent. L’horizon européen du gouvernement français ne doit pas se limiter à Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg. Je me souviens qu’après la chute du mur de Berlin, j’avais créé une association appelée « Paris II – Pays de l’Est », destinée à créer des liens d’amitié entre juristes français et est‑européens. Nous avions récolté des fonds auprès d’entreprises privées et étions allés à l’université de Pecs, en Hongrie, et à l’université Charles à Prague, pour apporter aux étudiants des livres de droit en français. Nous avions aussi expédié des manuels à Cracovie, en Pologne. Nombreux étaient les professeurs et étudiants, à l’époque, dans ces trois pays, à comprendre, lire et travailler en français. Leur joie était à la hauteur de leur attente et de l’admiration qu’ils portaient à l’héritage juridique de notre pays. Nous avons même réussi, avec difficulté, à lever des fonds pour financer les études en France de deux étudiants. Avec difficulté, oui, et c’est un euphémisme, car nous n’avons pas été suivis par les pouvoirs publics. Nous ambitionnions de prendre en charge davantage d’étudiants, mais avons été contraints de les laisser sur le bas‑côté, alors qu’ils croyaient en nous, en notre langue, notre pays et notre système juridique. Au même moment, les Allemands, eux, ont débloqué d’importants moyens pour nouer des relations avec ces universités, accueillir des professeurs, des étudiants en thèse. Et, en quelques années, notre influence, notre aura, s’est effilochée au profit de nos voisins… Cela reste, aujourd’hui encore, un crève‑cœur, d’autant plus que nous savions que ces pays finiraient par rejoindre l’Union européenne. Nous aurions pu les aider à former leurs cadres et ils auraient pu devenir nos relais de puissance.
L’Europe a besoin de la France autant que la France a besoin de l’Europe. C’est le destin de la France de poursuivre le chemin entamé avec ses voisins, ses partenaires, ses « frères et sœurs de civilisation ». Pour cela, il lui faut cultiver sa singularité. L’Europe est à la croisée des chemins, et c’est là que doit se tenir la France.