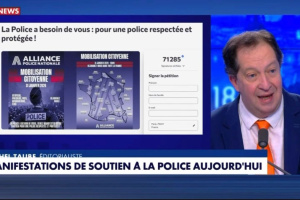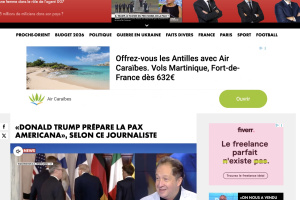Il reste deux jours ! La Galerie Art-Z met en lumière par une exposition-événement, un mouvement artistique d’importance majeure, avec les œuvres de deux générations de sculpteurs zimbabwéens.
Il reste deux jours ! La Galerie Art-Z met en lumière par une exposition-événement, un mouvement artistique d’importance majeure, avec les œuvres de deux générations de sculpteurs zimbabwéens.
La première génération, dont les représentants les plus célèbres sont John Takawira, Nicholas Mukomberanwa, Henry Munyaradzi, Fanizani Akuda et Bernard Matemera, a initié ce mouvement dans les années 60.
Dans les années 80 et 90, les élèves des premiers sculpteurs donnent eux aussi naissance à des styles très originaux. Colleen Madamombe, Zachariah Njobo, Lameck et Witness Bonjisi, Norbert Shamuyarira, Brighton Sango et bien d’autres viennent à leur tour enrichir ce mouvement.
Ces jeunes artistes ont surmonté plusieurs décennies du règne sans partage et despotique de Robert Mugabe. Leurs œuvres s’affirment, belles et dignes, faisant écho à celles des premiers sculpteurs, qui avaient dû défendre la culture shona contre les ravages d’un régime colonial de quasi-apartheid.
La maison des pierres
Le Zimbabwe était connu dès le 14ème siècle pour sa cité-forteresse de pierre, siège de l’empire du Monomotapa, qui s’étendait également en partie sur le Mozambique et l’Afrique du Sud. Cet édifice en pierres granitiques sans ciment est le plus spectaculaire après les pyramides.
« Zimba-mabwe » signifie en shona : les « maisons de pierre ».
En 1670, La Fontaine, dans sa fable « Les deux amis », évoque déjà le royaume du Monomotapa.
On y retrouva des oiseaux en pierre, qui devinrent l’emblème du pays, et furent emportés par Cécil Rhodes lors de sa conquête de ce qui s’appellerait la Rhodésie. Depuis plusieurs siècles, les pierres se taisaient. Elles étaient à l’écoute. De vastes gisements de pierre serpentine sommeillaient ainsi dans le nord du pays le long de la « grande faille » (Great Dyke).
Les pierres, depuis sept siècles, écoutaient… Elles écoutaient la musique des premières pluies, la berceuse des jeunes mères, le vent dans les branches d’eucalyptus, le claquement des mains des voisins qui se saluent « j’ai bien dormi si tu as bien dormi », l’écho de l’orage et le rugissement des lions.
Lors des différentes guerres, elles avaient fait une place aux morts, venus rejoindre leurs ancêtres. Ceux de la guerre des Nébélés de Mzilikadzi et Shaka contre les Shonas, puis de Lobengula contre Cécil Rhodes. Enfin, les nombreux morts de la guerre d’indépendance, qui dura de 1963 à 1979 vinrent rejoindre le sol.
Patientes, les pierres serpentine avaient écouté les légendes d’Amai Takawira, la mère des trois futurs grands sculpteurs John, Bernard et Lazarus Takawira. Le peuple Shona a depuis toujours un rapport privilégié à la pierre. Elle est vivante, et contient, comme la terre, les esprits et l’âme des ancêtres.
Au milieu du XXème siècle, un anglais, Frank Mc Ewen, vint contribuer à renouer avec l’esprit des pierres par la création artistique.
L’apport de Frank Mc Ewen

Né en 1907, dans le Devon, ce Britannique est élevé dans une famille d’amateurs d’art avant-gardistes. Son père collectionne les statues africaines du Ghana et du Nigéria, et sa mère, née en France, les tableaux impressionnistes.
A 18 ans, Mc Ewen décide de partir en France, fait le tour des musées, puis parcourt l’Europe, exerçant divers métiers. A Paris, il suit les cours de Foçillon, redécouvre l’art dit « primitif », et, très vite, se lie d’amitié avec les artistes de l’Ecole de Paris: Matisse, Picasso, Léger, Giacometti…
Passionné par les méthodes d’enseignement artistique de Gustave Moreau (qui incitait ses élèves, dont Matisse, à chercher leur propre style en eux-mêmes et hors des écoles), Mc Ewen crée à Toulon un atelier où il expérimente avec succès ses vues sur le retour aux « sources vitales ».
Pendant la guerre, il est agent de renseignement pour les forces alliés.
Nommé conseiller artistique au British Council à Paris à la Libération, il fait connaître Henry Moore en France, et organise en 1945 la première exposition Picasso-Matisse à Londres, puis une série d’expositions d’artistes français (Braque, Bonnard, Léger, Dufy).
Mc Ewen est également adepte du psychologue Carl G. Jung, et nourrit une nostalgie évidente à l’égard des sociétés dites « primitives » et de leur prétendue « spontanéité ».
En 1952, il écrit, dans l’introduction du catalogue de l’exposition « Peintres de l’Ecole de Paris » (organisée à Londres) : « Si quelque nouvelle forme d’art, pleine de force et de vitalité devait apparaitre ou était déjà née quelque part dans le monde, les esthètes professionnels et les critiques décadents seraient les derniers à en prendre conscience (…) Une telle manifestation originale de la créativité permanente des artistes naîtra de leur confrontation à un nouvel environnement, à des stimulations nouvelles. »
Cette profession de foi est une anticipation de sa propre expérience au Zimbabwe…
La National Gallery de Salisbury
En 1952, le gouvernement britannique réunit des experts pour travailler à la conception d’un musée d’art moderne en Rhodésie. Frank Mc Ewen travaille aux plans de ce bâtiment, consulte Le Corbusier, et contribue ainsi à la naissance, en 1955, de la National Gallery de Salisbury, saluée unanimement comme l’un des plus beaux édifices modernes à usage de musée .
Ce musée est destiné par les autorités rhodésiennes à l’exposition d’artistes blancs et occidentaux, à l’exclusion de l’art africain.
Financé en grande partie par le milliardaire Sir Stephen Courtauld, le musée dispose d’un fonds initial assez consistant, permettant à Mc Ewen d’acquérir une collection de chef-d’œuvres de Rodin, Henry Moore, Reynolds, Gainsborough, Morillo, Goya et même Rembrandt.
A son arrivée, après une année de navigation sur son voilier entre Paris et Le Cap, Mc Ewen constate : « En Rhodésie du Sud, les Blancs comme les Noirs ont pratiquement oublié la tradition culturelle des hommes de leur race. Les Européens, installés dans le pays depuis cinquante ou soixante ans, sont, pour la plupart, des agriculteurs et des commerçants qui n’ont apporté avec eux aucune œuvre d’art, ancienne ou moderne. Les populations africaines, pour autant qu’on le sache, n’ont jamais pratiqué les arts plastiques, mais elles possèdent une musique et des danses traditionnelles admirables ».
Confronté à l’absence de toute collection d’artistes Africains, Mc Ewen déclare : « Il ne reste qu’à faire de l’art, l’idée de Gustave Moreau était qu’on peut faire de l’art avec n’importe qui ».
Une école clandestine
Avant même l’inauguration du musée, Mc Ewen se met à l’écoute de la culture shona, discute avec les africains, voyage dans le pays, apprend ses mythes. C’est le début d’un travail de longue haleine, qui, au terme de quinze années d’attention continue, verra Mc Ewen circuler dans le pays Shona et « adopté » par ses habitants, à l’instar de ses amis Suzanne Wenger et Uli Beier au Nigéria.
Après l’inauguration du musée en 1956, Mc Ewen remplace les policiers, désignés d’office comme gardiens, par des musiciens, peintres ou conteurs shonas, et crée pour eux, avec sesfonds personnels, un atelier d’initiation à la peinture. Cette « école expérimentale », clandestine durant plus d’un an, est soumise aux attaques répétées du « Rhodesia Herald ». Durant 17 ans, Mc Ewen et son atelier ne pourront exister (dans un régime de quasi-apartheid) que grâce au soutien actif de personnalités éminentes du monde de l’art et amis de longue date : Tristan Tsara, Michel Leiris, Daniel-Henry Kahnweiler, William Fagg, Roland Penrose…
Émergence d’un mouvement artistique
 Après quelques années, les premiers artistes africains sont encouragés par Mc Ewen à travailler la pierre, utilisant des outils mis à leur disposition. Il obtient pour eux des « laisser-passer » exceptionnels pour qu’ils puissent circuler librement dans le pays.
Après quelques années, les premiers artistes africains sont encouragés par Mc Ewen à travailler la pierre, utilisant des outils mis à leur disposition. Il obtient pour eux des « laisser-passer » exceptionnels pour qu’ils puissent circuler librement dans le pays.
Mc Ewen insiste fortement sur la nécessité de puiser aux sources de la mythologie shona.
C’est ainsi qu’en l’absence de toute tradition plastique va émerger en Rhodésie un mouvement artistique que Mc Ewen qualifiera le premier de « sculpture Shona ».
Les influences probables du mouvement
Parallèlement aux ateliers, et dès ses débuts, la National Gallery accueille des expositions d’envergure : « De Rembrandt à Picasso », puis, en 1962, le « Premier Congrès International de la culture Africaine », sorte d’avant-première du Festival des arts nègres, organisé par Senghor à Dakar quatre années plus tard (1966).
S’il est difficile de déterminer l’impact de ces événements sur les premiers sculpteurs, il est certain que Mc Ewen les a encouragés à produire des formes « susceptibles de plaire à leurs ancêtres, ou aux esprits ».
Le travail de la pierre
 Dans un premier temps, le sculpteur choisit son matériau de prédilection (la « Springstone », une variété de serpentine, noire et très dure pour John Takawira, par exemple). Il va travailler les blocs dont la forme, a priori, lui « parle ».
Dans un premier temps, le sculpteur choisit son matériau de prédilection (la « Springstone », une variété de serpentine, noire et très dure pour John Takawira, par exemple). Il va travailler les blocs dont la forme, a priori, lui « parle ».
Avec l’évolution du mouvement, les blocs de pierre sont transportés chez les sculpteurs, qui travaillent désormais en plein air, en dialogue permanent avec le matériau.
Ils attaquent la roche directement, sans étude préalable, et, s’ils dessinent, c’est sur la pierre elle-même. La forme peu à peu « se libère ».
Souvent, les traces d’outils sont laissées apparentes, témoignages de cette lutte contre la dure serpentine. La pierre est polie (limée et passée au papier de verre), brûlée, puis enduite de cire incolore, qui fixe sa couleur.
Chaque artiste lui donne une texture différente : à la fois brute et polie chez John et Lazarus Takawira, surface lisse des visages aux traits minimalistes chez Henry Munyaradzi, douceur des formes rondes chez Fanizani Akuda, pierre brute des femmes en robes et cheveux chez Colleen Madamombe.
Chaque artiste travaille à sa manière le poli ou le brut. Au premier regard, on reconnaît le style de chacun à la texture qu’il donne à la pierre.
Le travail artisanal, sans outil électrique, permet un dialogue avec les couches successives de la serpentine, qui se dévoilent dans l’avancée du travail du sculpteur.
Ce processus se double de la certitude que la pierre est un matériau noble, exigeant qui, par sa dureté, semble faire écho à la mission dont le sculpteur est secrètement investi : retrouver, par la création, les valeurs du peuple shona, qui, une fois incarnées dans la dureté du matériau (ou dans la pierre) se transmettent aux générations futures.
Olivier Sultan
Directeur de la Galerie Art-Z
Sculpteurs du Zimbabwe : Deux générations d’artistes contemporains
Exposition: jusqu’au 14 juillet 2018
Galerie Art-Z : 27 rue Keller 75011 Paris .