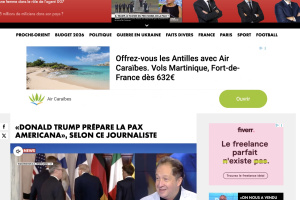Monsieur,
Vous avez bien voulu me demander mon sentiment sur l’enquête que vous avez faite, il y a trois ans déjà, sur le socialisme. Voulez-vous me permettre tout d’abord un compliment qui a l’air d’une impertinence mais qui, je vous assure, est très sérieux ? Vous avez compris. Je me rappelle qu’il y a deux ans, à la Chambre, comme je disais : non, à M. Léon Say (Bio*) qui nous appelait socialistes d’État, il me répondit avec une stupéfaction admirable : Quoi ! Vous n’êtes pas socialistes d’État ! Qu’êtes-vous donc ? M. Léon Say confondait le socialisme d’État, qui respecte la propriété capitaliste et qui en tempère seulement les effets par une réglementation toute extérieure avec le socialisme collectiviste ou communiste qui veut transformer la propriété sociale. Il ne soupçonnait même pas que bien loin d’être des socialistes d’État, nous tendons à la suppression de l’État, c’est-à-dire de la force contraignante qui donne à l’exploitation des non-possédants par les possédants une forme juridique. Quand la communauté sociale aura été vraiment organisée, quand il n’y aura plus, dans l’humanité réconciliée, antagonisme des classes, l’État lui-même disparaîtra.
Vous n’avez commis, Monsieur, aucune erreur de ce genre : et vous connaissiez notre doctrine en ses principes aussi bien qu’en ses nuances avant d’interroger capitalistes et prolétaires.
Et si les exemples d’ignorance illustre ne surabondaient, je ne me risquerais point à louer votre exactitude et votre pénétration.
Ce sont les événements sensationnels de l’année 1891-92 (Note 1), la manifestation du 1er mai, la fusillade de Fourmies (Note 2), l’élection de Lafargue* à Lille qui vous ont donné l’idée de cette enquête. Le socialisme vous est apparu alors dans la vive lueur de l’actualité : mais vous avez bien vu tout de suite qu’il n’était pas une surprise, un événement sans lendemain, une mode sans profondeur : en vérité, tout le mouvement des faits et des esprits depuis un demi-siècle y aboutit et s’y résume. Aussi votre enquête, bien qu’elle remonte à trois ans déjà, n’a pas vieilli : aujourd’hui comme alors le socialisme est toujours au premier plan et il s’y est développé.
Partout en Europe, il s’est affirmé comme un parti à la fois parlementaire et révolutionnaire. En Allemagne, il a continué sa tranquille et irrésistible croissance, et il a fait échec aux lois de réaction préparées contre lui (Note 3). Sans sortir de sa prudence systématique, il a été conduit par la force des choses à la lutte directe contre l’Empereur, et c’est à une double révolution à la fois politique et sociale qu’il s’achemine. En Autriche, le parti socialiste conduit l’agitation par le suffrage universel et il se dégage nettement de l’antisémitisme ; il n’entend pas, comme celui-ci, opposer les unes aux autres des catégories diverses de la bourgeoisie ; mais toute la classe prolétarienne à toute la classe bourgeoise (Note 4). En Belgique, les élus socialistes représentent près d’un sixième du Parlement, et par leur propagande incessante, par leurs fédérations, par les coopératives, ils sont en contact permanent avec le peuple ouvrier (Note 5). En Angleterre (Note 6), si le mouvement ouvrier n’a pas abouti encore à la constitution d’un parti socialiste, si la lutte semble circonscrite presque partout entre conservateurs et libéraux, il est certain que l’esprit politique et socialiste pénètre de plus en plus les Trades-Unions, et là aussi l’heure est proche où au Parlement même le parti socialiste pourra paraître et agir.
Enfin en France, il n’est pas téméraire de dire que depuis trois ans (Note 7), toutes les luttes, tous les événements ont grandi le socialisme.
C’est lui qui par une énergie révolutionnaire appliquée au Parlement a eu raison des ministères de combat à la Dupuy* et de la Présidence Périer*. Et ceux-là sont bien naïfs qui s’imaginent que désormais on pourra faire sans lui une politique réformatrice. Pour que les radicaux ou les progressistes puissent se passer de lui dans l’œuvre de réforme, il aurait fallu qu’ils renversent sans lui les gouvernements de réaction.
N’ayant pu détruire sans nous, on ne pourra bâtir sans nous.
Et c’est pour affirmer notre force en même temps que notre cohésion et notre pleine possession de nous-mêmes que nous soutenons avec une inaltérable fidélité le premier ministère réformateur.
Mais ici que nos adversaires se gardent de toute illusion. À l’heure où nous étions un parti de combat et d’assaut, ils nous croyaient incapables de tout effort créateur, de toute action gouvernementale et notre libre discipline a déjoué tous leurs calculs. Aujourd’hui, par une illusion inverse, ils s’imaginent que cette discipline volontaire et cette sagesse calculée ont affaibli nos facultés de combat et émoussé nos énergies révolutionnaires.
Ils se trompent étrangement : nous traçons toujours la même route, celle par laquelle le prolétariat arrivera au pouvoir. Nous rencontrons tantôt la montagne, tantôt le ravin, et il nous faut construire tantôt des ponts, tantôt des tunnels. Mais c’est toujours le même chemin, le même but,
et la même force sûre d’elle-même, réfléchie et ardente, consciente et indomptée. Aussi, devant toutes les manifestations multipliées de la force socialiste dans tous les pays, nous pouvons lire avec philosophie, dans une de vos interviews, le mot de M. Hansemann, le puissant directeur de la Banque d’Escompte de Berlin « Le socialisme est en décroissance. »
Le Congrès international, qui aura lieu à Londres au mois d’août prochain et qui réunira les délégués de tous les groupements ouvriers et les élus socialistes de tous les Parlements, bien qu’il ne puisse exercer sur les faits une action immédiate et qu’il n’ait pas encore d’efficacité légale, sera à coup sûr la plus grande force organisée qui soit au monde (Note 8).
Et, faut-il vous l’avouer, Monsieur ? Ce ne sont pas les objections et les conceptions que vous avez recueillies de Messieurs les capitalistes, et que vous avez notées avec une candeur bienveillante où il entre parfois bien de l’ironie, qui arrêteront l’idée socialiste.
Il me semble qu’on peut ramener à trois ou quatre, les pensées essentielles du haut patronat, de la haute économie politique, et de la haute Banque, sur le socialisme. D’abord, à entendre les grands patrons comme celui de Roubaix, les ouvriers, sur l’excitation des meneurs et des politiciens, ne demandent qu’à travailler sans rien faire et à sommeiller
délicieusement dans les grands hôtels bâtis par les patrons. Déjà, dans Les Temps difficiles de Dickens (Note 9), le parvenu Bonndecby, nous assurait que les ouvriers ne rêvent que de manger de la soupe à la tortue avec des cuillers en or. Et il paraît que si tous les travailleurs au lieu de s’exténuer pour une minorité, recevaient l’intégralité du produit créé par eux, s’ils pouvaient, par suite, s’assurer peu à peu des logements confortables et commodes, il n’y aurait plus que confusion et barbarie : tous voudraient habiter des châteaux, et ou bien ils s’entasseraient à étouffer dans la chambre à coucher de madame la marquise ou bien pour faire à leur tour des appartements les plus luxueux, ils déménageraient sans cesse comme les misérables qui rôdent de garni en garni. On ne saura jamais ce que les capitalistes, en occupant solidement tous les châteaux, épargnent de courses folles aux prolétaires. Au moins, aujourd’hui, quand les pauvres déménagent, ils (Note 10) savent d’avance que s’ils quittent un taudis c’est pour un autre, leur choix est sagement circonscrit, et ils n’ont pas à disputer à leurs camarades des lambris d’une nuance préférée. « Là-dessus, lisez Eugène Richter*, » nous dit le banquier allemand.
On nous dit encore : Mais le capital, c’est le produit du travail et de l’épargne! Et puisque les capitalistes prêtent aux salariés le capital économisé par eux, pourquoi ne retireraient-ils pas, sous forme de dividende, de loyer, de rente, de fermage, de bénéfice, l’intérêt de leur argent? Et M. Christophle, alors gouverneur du Crédit Foncier, choisit un doux exemple agricole :
« J’ai économisé; avec mes économies j’ai acheté un champ : si je le prête à un autre, je lui rends service : n’est-il pas juste qu’il me dédommage? » À la bonne heure : mais je me demande d’abord pourquoi les financiers choisissent des exemples aussi innocents, aussi idylliques. Pourquoi, au lieu de cette sorte de leçon pastorale ne nous expliquent-ils pas, avec précision, comment s’est constitué, comment a grandi leur capital à eux? Avez-vous remarqué, Monsieur, comment, pour la première fois depuis l’origine de l’histoire (sauf la première période théocratique) les souverains nous cachent aujourd’hui le secret de leur action, les ressorts de leur pouvoir? Les rois, les empereurs, Louis XIV, Frédéric II, Napoléon, nous ont laissé leurs mémoires, les hommes d’État, les diplomates, nous ont laissé les leurs. Nous savons précisément comment on fait ou défait les Constitutions, comment on vole une province, comment on gagne une bataille. Seuls les grands capitalistes, qui sont les vrais rois, et les vrais généraux de notre temps, s’enveloppent de mystère : nous n’avons ni les Souvenirs de M. Christophle, ni les Mémoires de M. de Rothschild, ni l’Histoire de ma vie de M. Bleichroeder. Et quand on les interroge, quand vous-même les interrogez, ils répondent par des histoires de berger.
« Il y avait une fois un brave homme qui, avec son épargne, avait acheté un petit champ. » Ce sont des capitalistes d’Arcadie!
Au demeurant, et pour toucher au fond, la question est pour eux fort mal posée. Il ne s’agit pas de savoir si des particuliers, tant qu’ils détiendront les moyens de production, pourront faire travailler à leur profit les autres hommes. Cela va de soi. Ayant la propriété, ils ont la force et ils font la loi.
Mais ce qu’il faut savoir, c’est si la société humaine se résignera longtemps encore à un mode de propriété qui soumet ainsi la multitude à quelques hommes. Une telle société, devant l’histoire et la conscience, ne peut avoir qu’un titre : c’est d’être nécessaire. Quand les hommes commencent à entrevoir la possibilité d’une société nouvelle, le titre de la société ancienne est par cela même caduc. Toute sa légitimité lui venait de sa nécessité et elle tombe avec celle-ci.
Ah! je sais bien : vos interlocuteurs capitalistes affirment qu’un ordre social nouveau est impossible parce qu’il faudrait changer la nature humaine. « Il y aura toujours des pauvres et des riches », comme on disait il y a quelques siècles : « Il y aura toujours des nobles et des roturiers », comme Aristote disait il y a deux mille ans. « Il est dans la nature humaine qu’il y ait des esclaves. » Et l’on confond ainsi de siècle en siècle, de société en société, de privilège en privilège, la nature humaine avec les formes sociales transitoires qui la déterminent un moment sans la captiver à jamais. Et d’ailleurs, qui ne voit que c’est la nature humaine elle-même qui condamne aujourd’hui le régime capitaliste ? Qui ne voit que l’éternel et universel égoïsme humain se révolte aujourd’hui contre une forme de société qui presque partout lui fait violence ? Oui, l’humanité est capable de dévouement, d’abnégation, de soumission, mais à une condition : c’est que la puissance même devant laquelle
elle s’incline lui apparaisse comme irrésistible et supérieure.
Or, la puissance du Capital n’apparaît ni comme sacrée, ni comme invincible. Elle n’a pas pour la conscience un caractère divin ou une beauté idéale : et à mesure que la nation prend conscience d’elle-même, et que les travailleurs s’éveillent et s’organisent, la transformation de la propriété capitaliste en propriété nationale au profit des travailleurs semble possible.
La société capitaliste n’a donc pas au-dessus d’elle un Dieu qui la légitime et un prêtre qui la consacre; et elle a derrière elle un successeur qui grandit, qui la guette et qui demain la brisera. Comment donc l’universel besoin de bien-être, d’indépendance, de vie heureuse, c’est-à-dire comment la nature humaine elle-même n’aurait-elle pas raison d’un régime qui n’inspire pas la vénération et qui tous les jours inspire moins de crainte? C’est d’un mouvement irrésistible que nous allons tous à la Révolution.
Et on n’y échapperait pas, même si la société nouvelle devait être la barbarie opprimante et déprimante que semblent imaginer nos contradicteurs. Mais ils s’en font l’idée la plus grossière, la plus sommaire et la plus fausse. En même temps qu’elle organisera l’action sociale, elle suscitera et développera les énergies individuelles. Nul ne peut enfermer dans une formule étroite la complexité presque infinie de l’ordre socialiste en préparation.
Il aura deux pôles s’équilibrant l’un l’autre : la toute-puissance sociale réalisant la justice, la toute puissance individuelle affirmant la liberté. Et tant pis pour ceux qui ne démêlent pas que le progrès même, que l’histoire même est la conciliation croissante des contraires et même des contradicteurs !
Aussi, quand on se borne à dire que le socialisme abolira la propriété individuelle, la formule est trop pauvre et fausse. Il abolira la propriété capitaliste, mais sous d’autres formes la propriété individuelle subsistera, et de ses rapports infiniment variés à la propriété sociale résultera la société la plus compliquée, la plus riche et la plus diverse qu’aient connue les hommes. Aujourd’hui même quand on se borne à dire que la société a pour base la propriété individuelle, on dit un mot qui n’a presque pas de sens et qui ne répond pas à toute la réalité. En fait, en même temps qu’elle est individuelle, la propriété est familiale puisque le père ne peut en disposer, au moins dans une très large mesure, que pour ses enfants. Elle est encore gouvernementale, puisque l’impôt en prélève incessamment une part. Mais surtout elle est capitaliste, car ce sont les lois générales et impersonnelles du capital, la plus-value, la concurrence qui règlent, bien plus que l’effort personnel et la prévoyance individuelles, la distribution de la propriété, et les individus sont aujourd’hui le point d’attache de la propriété bien plus qu’ils n’en sont les créateurs et les maîtres. Elle les tient et les gouverne bien plus qu’ils ne la gouvernent
et la tiennent. Il ne faut donc pas opposer, comme on le fait trop sommairement, propriété individuelle et propriété sociale ; l’ordre socialiste les conciliera par l’infinie diversité de ses modes juridiques et économiques, et nous allons à la pleine liberté individuelle comme à la pleine justice sociale.
Comme ils se trompent donc ceux qui croient que nous sommes tentés d’abandonner dans je ne sais quels marchandages ou quelles équivoques de tactique une part quelconque de notre haut idéal! Nous ne guettons pas des miettes de pouvoir tombées de la table du maître. Nous voulons et nous aurons le pouvoir tout entier pour notre idéal tout entier. Nous
n’avons pas besoin d’être des émeutiers en un temps et en un pays où la légalité, même bien maniée, est révolutionnaire, et où le régime parlementaire peut être un formidable engin de dislocation et de rénovation.
Nous nous servons contre la société présente, injuste et barbare, du mécanisme même qu’elle a créé, et c’est dans le vieux clocher, avec la cloche qui a sonné toutes les fêtes bourgeoises, que nous sonnerons les temps nouveaux.
Bien à vous, Jean Jaurès.
Cette lettre a été écrite au moment du Ministère Bourgeois*.
Notes :
1 Plusieurs événements cette année là montrent l’essor et la nouvelle puissance des socialistes :
– 1er mai 1891 : agitation pour la journée de 8 heures à l’appel des guesdistes
– 1891 : organisation du Parti Ouvrier Français, de Guesde, qui devient le premier parti de type moderne
– mai 1891 : Encyclique Rerum Novarum
– 1892 : adoption par la Fédération des syndicats du mot d’ordre de la grève générale ; congrès constitutif de la Fédération des Bourses du travail ; succès socialistes aux municipales.
2 Fourmies est une commune du Nord où a lieu une fusillade le 1er mai 1891; une manifestation de centaines d’ouvriers grévistes de l’usine « La Sans-Pareille » réclamant la journée de 8 heures à l’appel des guesdistes est réprimée par la troupe qui tire ; il y a neuf morts dont deux enfants, et 60 blessés. Le héros de cette journée est Culine*.
Cet événement accélère l’évolution des ouvriers français vers le socialisme et entraîne l’élection de Lafargue à Lille.
3 Le socialisme allemand est divisé entre les lassalliens et les marxistes.
Lassalle a fondé l’ADAV (Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein), selon laquelle l’édification du socialisme doit se faire dans le cadre national, non par la révolution, mais par le développement d’une législation sociale sous l’impulsion de l’État. En revanche, le SDAP (Sozialdemokratische Arbeitpartei), parti social-démocrate des travailleurs, dirigé par Bebel et Liebknecht, regroupe depuis le congrès d’Eisenach en 1868 les marxistes et lassalliens dissidents qui sont partisans de l’internationalisme prolétarien et s’opposent à la construction d’une « Petite Allemagne » par la Prusse.
Mais devant les menaces que font peser sur eux les poursuites de la police et le manque d’unité, ils tiennent en 1875 un congrès à Gotha pour la fusion, qui réunit deux fois plus de lassalliens que de marxistes.
Le compromis réalisé affirme des principes généraux de tendance marxiste (lutte des classes, révolution prolétarienne, socialisation des moyens de production) ainsi que des revendications réformistes pour l’action pratique (démocratisation des pouvoirs publics, législation sociale, formation de coopératives de production avec l’aide de l’État).
Le nouveau parti socialiste bénéficie d’une organisation solide et mène une active propagande dans les villes. Parallèlement à l’augmentation générale du nombre d’ouvriers, leur mécontentement s’accroît par suite de la crise économique. Ainsi les socialistes obtiennent 500.000 voix et 12 sièges aux élections législatives de 1877.
Le patronat industriel s’inquiète des succès électoraux des socialistes et du développement de leur propagande. De plus, Bismarck s’est déclaré l’ennemi juré du socialisme depuis que Bebel et Liebknecht ont refusé en 1870 de voter les crédits militaires et qu’ils se sont solidarisés avec la Commune. En outre, le 11 mai et le 2 juin 1878 ont lieu des attentats contre l’empereur Guillaume Ier. Bismarck dissout alors le Reichstag, fait mener une campagne de presse contre les « fauteurs de subversion »; les élections renforcent les partis conservateurs.
Il est ainsi possible en octobre 1878 de faire voter des lois d’exception, les lois antisocialistes, renouvelées tous les deux ans jusqu’en 1890, qui contraignent le parti à dissoudre son appareil central et ses associations locales; les journaux sont saisis, les réunions interdites, les socialistes assignés à résidence forcée et les chefs poursuivis.
Mais ces mesures sont impuissantes à détruire le parti social-démocrate ; des organisations socialistes camouflées renaissent, des réunions secrètes sont tenues, un journal, des livres et des brochures sont imprimés hors d’Allemagne.
Néanmoins, des divergences se créent entre les socialistes de l’intérieur et ceux de l’extérieur, de même qu’entre les partisans de l’action révolutionnaire et le groupe parlementaire qui veut agir dans la légalité.
Malgré ces difficultés et la répression, les socialistes connaissent des succès électoraux, recueillant 549 000 voix en 1884, 763 000 voix en 1887 et 1,42 million de voix en 1890.
4 Le Parti social-démocrate autrichien naît en décembre 1888 à la suite d’un congrès d’unification, il est dirigé par Victor Adler. Il remporte un succès aux élections de 1891, une de leurs revendications principales étant le suffrage universel (obtenu en 1905).
5 Le Parti ouvrier belge est créé en 1885, par les Flamands et les Bruxellois, rejoints en 1890 par les Wallons. C’est au départ une alliance de coopératives, mutuelles et cercles politiques dont l’objectif est d’unifier l’ensemble du mouvement ouvrier. Bien que la Belgique soit le pays le plus industrialisé d’Europe continentale, la diffusion du syndicalisme et du socialisme y est relativement lente, car l’industrie belge est composée de petites entreprises, ce qui freine le développement des mouvements revendicatifs. Mais lors de la grève de 1891 pour le suffrage universel, le parti montre sa puissance et, obtenant 26 sièges à la chambre lors des élections de 1894, devient une force parlementaire. Il s’oriente vers le réformisme, malgré la présence d’une
gauche révolutionnaire.
6 En Angleterre, les trade-unions, qui ont participé en 1864 à la création de la Ière Internationale, tiennent un congrès à Manchester en 1868 où ils décident la création du Trades Union Congress, grande organisation confédérale réunissant l’ensemble des syndicats. Ceux-ci sont en général des unions de métier, qui existent depuis 1824,
dont l’entrée est restreinte par l’exigence d’une qualification professionnelle et de cotisations élevées ; elles ne concernent au départ qu’une aristocratie ouvrière. Puis après 1870, le syndicalisme connaît un grand essor dans des professions jusqu’alors sans défense et peu qualifiées. Mais ce mouvement est stoppé par la crise économique des années 1873-79.
C’est après 1880 que se manifeste un réveil socialiste et syndical et que la question sociale redevient d’actualité en Grande-Bretagne. A partir de là se créent des mouvements socialistes, dont certains à tendance révolutionnaire qui mènent une propagande active.
A cause de la crise économique, le trade unionisme connaît une période de repli jusqu’en 1889, le vieil unionisme voulant maintenir les acquis et faisant alliance avec le mouvement libéral : c’est l’alliance Lib-Lab, dénoncée par les socialistes.
Le réveil syndical se manifeste lors de la grande grève des dockers de Londres à l’été 1889, qui sont dirigés par de nouveaux leaders ouvriers, dont John Burns. L’agitation se propage, des syndicats se créent ou reprennent vie. On constate ainsi que de 1888 à 1892, le nombre d’adhérents passe de 750 000 à 1,6 million, cet essor étant particulièrement visible chez les manœuvres.
De nouvelles revendications naissent, notamment la journée de 8 heures et un minimum légal de salaire. Les dirigeants socialistes ne veulent plus de l’alliance avec les libéraux, afin d’avoir des représentants ouvriers au Parlement. En janvier 1893, le congrès ouvrier et socialiste que se tient à Bradford décide la fondation d’un Parti Indépendant du Travail (Independent Labour Party) ; ce dernier ne se définit pas comme parti socialiste (le Parti Travailliste ne sera créé qu’en 1906), mais son programme est socialiste. L’ILP, qui se veut parti réformiste et orienté vers l’action parlementaire, adhère à la IIème Internationale.
Mais dans l’immédiat, l’État est solidement tenu par les conservateurs (Tories), avec une parenthèse libérale (Whig) de 1892 à 1895.
La tactique des socialistes est le labour alliance : l’alliance entre les trade-unions, qui certes sont modérés, mais qui sont les seuls à pouvoir entraîner les masses, et les militants socialistes.
7 Jaurès écrit en 1895.
8 Le Congrès de Londres en 1896 rassemble une vingtaine de nations et oppose les deux tendances du socialisme, qui recoupe grossièrement l’opposition entre Marx et Bakounine : d’un côté les partisans de l’action politique, pour qui les critères du socialisme reposent sur le parti et la conquête du pouvoir politique ; de l’autre, les partisans de l’autonomie ouvrière (antiparlementaires, syndicalistes révolutionnaires,
libertaires), pour qui la lutte de classe prime l’action politique.
Les tenants de la première ligne sont majoritaires au congrès et exigent des autres leur ralliement aux principes du combat politique, autrement dit les luttes électorales.
9 Roman écrit par Charles Dickens (1812-1870) et publié en 1854. L’action se situe aux environs de 1850 et montre les débuts de la révolution industrielle, l’exploitation du prolétariat et la bonne conscience des hommes politiques et de la bourgeoisie. Le personnage de M. Bounderby, banquier, manufacturier et négociant, est celui d’un « self-made-man », d’origine pauvre qui revendique le fait de s’être élevé grâce à son caractère décidé dans l’échelle sociale.
10 Jaurès est acquis à l’idée de la lutte politique, et donc à l’utilité du régime parlementaire, pour parvenir au pouvoir.
Bios :
Léon Bourgeois (1851-1925)
Préfet de police de la Seine en 1887. Militant radical, il bat le général Boulanger aux élections, devient député de la Marne en 1888, puis sous-secrétaire d’État à l’Intérieur. Il est neuf fois ministre. Président du Conseil en 1895, il forme le premier ministère radical homogène, mais non soutenu par les radicaux, il dispose d’un majorité fragile à la Chambre et est en minorité au Sénat. Il doit démissionner en avril 1896 devant l’hostilité de la droite, en particulier au Sénat, sur le problème de l’impôt sur le revenu (il s’agissait d’un projet de réforme fiscale
visant à corriger les inégalités sociales et permettre de mener une politique de solidarité). (Il sera de nouveau ministre, Président du Sénat de 1920 à 1923, chef de la délégation française à la SDN. Il obtient le Prix Nobel de la Paix en 1920.)
Jean Casimir-Périer (1847-1907)
Il commence sa carrière politique comme chef de cabinet du ministre de l’Intérieur, son père, après 1870. Député en 1876, sous-secrétaire d’État à la Guerre en 1883, il démissionne. Il est réélu et devient Président de la Chambre. Président du Conseil en 1893, il veut restaurer l’ordre, réprime sévèrement les attentats anarchistes, s’oppose à la séparation des Églises et de l’État. Il est élu Président de la République en juin 1894 à la suite de l’assassinat de Sadi Carnot. Du fait de sa fidélité orléaniste (il est le petit-fils du ministre de Louis-Philippe) et de sa possession des mines d’Anzin, il est confronté à une violente hostilité des socialistes, puis d’une partie de plus en plus grande de la gauche. Au cours d’un procès intenté par Casimir-Périer contre le publiciste Gérault-Richard, Jaurès défendant l’accusé se livre à un véritable réquisitoire contre le Président de la République et toute la dynastie Périer (novembre 1894). Devant l’opposition des gauches et jugeant ses moyens d’agir insuffisants, il dit ne pas supporter cette « campagne de diffamation et d’injures » et démissionne le 5 janvier 1895.
Hippolyte Culine (Né en 1849)
Il est le héros de l’affaire de Fourmies. Originaire de Sedan, il s’installe dans le Nord où il est représentant de commerce. Son métier lui permet de mener une propagande socialiste active, qui s’accentue avant le 1er mai 1891. Au cours de cette journée, il est un des meneurs, harangue les ouvriers, prend la tête d’une partie de la manifestation sur laquelle tire la troupe. Arrêté, il est condamné à 6 ans de prison, puis libéré de manière anticipée en 1892. Il s’établit par la suite à Reims où il est gagné par l’anarchisme.
Charles Dupuy (1851-1923)
Professeur de philosophie, ancien inspecteur d’académie, républicain modéré, est élu député en 1885 et devient ministre de l’Instruction publique en 1892-93. Président du conseil et ministre de l’Intérieur d’avril à novembre 1893 à la suite du scandale de Panama, il se montre répressif envers le mouvement et les syndicats ouvriers, fait fermer le 1er mai
1893 la Bourse du Travail à Paris, puis fait occuper le 7 juillet la Bourse par la troupe, après une semaine de manifestations de rues nées d’une agitation étudiante sans origine politique. Les élections de 1893 se font sur la « question sociale » et entraînent l’élection d’une cinquantaine de socialistes. Dupuy démissionne. Président de la Chambre en 1893-94, il est resté célèbre par sa parole : « La séance continue », à la suite de la bombe de Vaillant. Il y a un nouveau cabinet Dupuy en mai 1894, tandis que Casimir-Périer est élu Président en juin. Dupuy fait voter une loi contre les théories anarchistes, qui transfère aux tribunaux correctionnels la « propagande anarchiste par voie de presse ». Elle est considérée comme des « mesures scélérates » par les socialistes, la plupart des radicaux et l’extrême droite. Le gouvernement tombe le 14 janvier 1895, après avoir été malmené par les socialistes et les radicaux et attaqué par Méline sur la question des chemins de fer. (Dupuy sera de nouveau président du conseil en 1898-99 et sénateur de 1900 à 1923.) Parallèlement a lieu une crise présidentielle avec Casimir-Périer.
Paul Lafargue (1842-1911)
Étudiant en médecine, républicain, d’abord proudhonien, il combat l’Empire. Il fait la connaissance de Marx à Londres, devient son disciple et son gendre. Membre de la Ière Internationale, il doit s’enfuir après l’échec de la Commune. A Londres de 1872 à 1882, il est en contact avec Guesde avec lequel il fonde le parti ouvrier français en 1882. Inculpé comme instigateur des émeutes de Fourmies le 1er mai 1891, il est condamné à un an de prison. Alors qu’il est en prison, le P.O.F. pose sa candidature aux élections législatives partielles de Lille où il est élu, mais perd son siège en 1893. Il est à cette époque le seul théoricien marxiste français d’envergure et vulgarise les thèses essentielles de l’économie politique marxiste, notamment dans Le Matérialisme économique de Karl Marx, 1884 et La Propriété, origine et évolution, 1895. Pour lui, la domination de la bourgeoisie s’exerce à travers les institutions de l’État, la morale et la religion. A la fin de sa vie, il s’éloigne du guesdisme et se suicide.
Eugène Richter (1838-1906)
Homme politique allemand, député libéral au Parlement d’Allemagne du Nord en 1867, puis au Reichstag. Chef du parti progressiste, il refuse de voter les lois antisocialistes et s’oppose à Bismarck.
Léon Say (1826-1896)
Economiste et homme politique français, petit-fils de Jean-Baptiste Say. Il s’oppose à l’Empire puis, après 1870, devient député, préfet de la Seine (1871), ministre des Finances (1872-73, 1875-79, 1882), sénateur (1876-1889), puis de nouveau député (1889-96). Il est partisan du libéralisme, défend la liberté commerciale et le libre-échange sous toutes leurs formes. Il est un fervent adversaire du socialisme, qui devient son souci essentiel à la fin de sa vie. Dans cette lutte, il utilise des projets de loi concernant les finances, en particulier en 1894 la proposition de Jaurès de faire de l’État le grand spéculateur sur les blés et en 1895 le projet d’impôt progressif sur les successions. Il contribue en 1889 à la création d’un nouveau groupe politique, l’union libérale, qui a pour ambition de rassembler les modérés de tous les partis.
 Prochain épisode : Lettre de Paul Deschanel, vice-président de la Chambre des députés
Prochain épisode : Lettre de Paul Deschanel, vice-président de la Chambre des députés