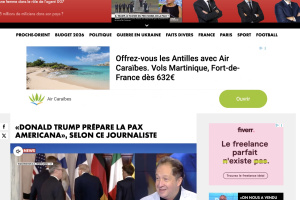Suharto, dictateur indonésien, et Moussa Dadis Camara en Guinée
L’information n’a pas fait trop de bruit ni la une de la presse. Pourtant, dans le premier pays à majorité musulmane de la planète, c’est une vraie déflagration. Le 11 janvier 2023, dans un discours prononcé à la télévision, le président Joko Widodo a reconnu de « graves violations des droits de l’homme » en Indonésie, dont certaines remontent à plus d’un demi-siècle.
Ce n’est pas encore une reconnaissance par la justice des crimes perpétrés par les forces de sécurité et diverses milices, mais au moins les « regrets » d’un chef de l’Etat pour des centaines de milliers de victimes depuis les années 1960.
A cette époque, l’Indonésie est dirigée par Sukarno, le « père » de l’indépendance. En 1955, il a accueilli la Conférence des pays non-alignés à Bandung. Confronté à une instabilité politique chronique – dans un archipel comprenant plus de 17 000 îles, dont près d’un millier habité, quelque 1 100 groupes ethniques et plus de 700 langues parlées –, il propose, en 1957, « pour le salut de la nation », de mettre un terme au modèle occidental de la démocratie et préconise à la place un gouvernement où tous les partis auraient leur place, proportionnellement à leur nombre de sièges au Parlement. Un choix qui ouvrirait la porte du « conseil national » aux communistes. Un plan qui ne reçoit ni l’appui de l’armée, ni celui des organisations nationalistes et islamistes.
Dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 1965, six généraux sont assassinés. L’action est menée par un « Mouvement du 30 Septembre », qui revendique des liens avec le président Sukarno et la gauche indonésienne. Une cinquantaine d’années plus tard, les historiens s’interrogent toujours pour savoir quelles étaient les véritables intentions de ce mouvement. Voulait-il s’emparer du pouvoir ? Contrer un coup d’Etat militaire en préparation avec l’aide de l’Agence centrale de renseignement américaine (CIA) et des services secrets britanniques ? Ont-ils été manipulés par le major-général et futur dictateur Suharto ? Ce qui est certain, c’est que le même jour, ce dernier s’empare du pouvoir réel. Il deviendra chef de l’Etat en 1967.
S’enclenche alors une répression terrible contre une « cinquième colonne » qui serait appuyée par la république populaire de Chine. En priorité, sont visés les membres du très important Parti communiste indonésien (PKI) – le troisième en nombre d’adhérents après ceux de la Chine et de l’Union soviétique – et de ses organisations satellites. Mais aussi les Indonésiens suspectés d’être de gauche ou trop modérés, et les membres de la communauté chinoise.
De Java à Sumatra, de Bali à Bornéo, d’octobre 1965 à l’automne 1967, selon les estimations, ce sont de 500 000 à 3 millions de personnes qui sont victimes de torture et d’assassinats, commis par l’armée et les milices islamistes. Un véritable génocide politique. Le PKI est dissous. Dans cette période de guerre froide, les Etats-Unis participent activement à la répression, aidant à la mise en place d’un « Ordre nouveau » à Djakarta, sous la férule de Suharto.
Arrêtés par centaines de milliers, des Indonésiens vont passer des décennies dans des prisons ou des camps. La propagande anti-PKI qualifie les militants communistes de « criminels », de « sans-Dieu » et de « traîtres à la patrie ». Les militantes se voient en plus attribuer le vocable de « putes » et vont subir nombre de violences sexuelles. Des exécutions auront encore lieu en 1990, comme celle d’Asep Suryaman, membre du comité central du PKI.
En avril 1995, également condamné à mort, le dirigeant communiste Yohannes Ruslan Wijayasastra décède à l’âge de 70 ans après trente ans de détention.
Alors que l’ancien ministre des Affaires étrangères Subandrio, l’ex-chef de l’armée de l’air Omar Dhani et l’ancien chef des services de renseignements Raden Suseng Sutarto, également condamnés à mort, sont libérés en août 1995.
Il faudra attendre 2004 pour que d’anciens membres du PKI – toujours interdit – puissent se présenter à des élections et 2006 pour que la mention « ex-prisonnier » disparaisse des cartes d’identité.
Mais les exactions de l’armée et des milices islamistes ne vont pas s’arrêter là. Vers la fin de la dictature de Suharto, dans les années 1990, des militants pro-démocratie sont pourchassés, abattus ou disparaissent. Ces exactions participent également de la guerre contre le mouvement indépendantiste au Timor oriental – une ancienne colonie portugaise annexée après la révolution des Œillets, par l’armée indonésienne, en 1975, devenue indépendante en 2002. Mais aussi dans les provinces de Nouvelle-Guinée occidentale – une ancienne colonie néerlandaise annexée en 1963 –, contre un mouvement indépendantiste papou, et d’Aceh, au nord-est de Sumatra, où un mouvement séparatiste s’oppose également à Djakarta.
En 2001, la nouvelle présidente Megawati Sukarnoputri, fille de l’ancien président Sukarno, présente des excuses à Aceh et à la Nouvelle-Guinée occidentale pour les violations des droits de l’homme qui y ont été commises pendant des décennies, mais, prévient que ses deux régions ne seront jamais autorisées à faire sécession.
En 2005, un traité de paix est signé entre Djakarta et les rebelles séparatistes d’Aceh. En trente ans de guerre, le conflit a fait quelque 15 000 morts. En 2006, l’Indonésie sera accusée par un rapport de l’Organisation des Nations unies de crimes contre l’humanité dans le Timor oriental. En 25 ans d’occupation, le nombre des victimes s’élèverait entre 100 000 et 180 000 personnes, soit un tiers de la population de l’époque.
La question qui se pose désormais, c’est combien d’années faudra-t-il encore attendre pour que l’on passe des regrets à la justice. Pour le moment, les tribunaux spéciaux, créés à cet effet, n’ont jamais pu faire condamner des membres de l’armée, toujours omniprésente dans la société et l’Etat indonésiens, ou de la police. Les inculpés ont toujours été acquittés.
Ces crimes de l’armée ne sont pas propres au cas indonésien ou à la période de la guerre froide.
Acte 2 : Guinée
En Guinée, au lendemain de la disparition du président Lansana Conté, le 22 décembre 2008, un groupe de militaire a décidé de prendre le pouvoir sous le nom de Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD). Avec à sa tête le capitaine Moussa Dadis Camara, foulant dès lors du pied l’ordre constitutionnel. De fait, dans les heures qui suivirent la prise du pouvoir, le gouvernement, ainsi que les institutions de la République, sont dissous, et la Constitution guinéenne suspendue.
Quant aux activités politiques et syndicales, elles sont temporairement interdites.
Comme souvent dans les putschs, les militaires expliquent leur action par le besoin de lutter « contre la corruption généralisée, l’impunité et l’anarchie » et la dénonciation d’« une situation économique catastrophique ».
Mais moins de deux ans plus tard, les Guinéens manifestent contre les promesses non tenues par les militaires. Le 28 septembre 2009, les opposants se donnent rendez-vous à Conakry, au stade du 28-Septembre. Principal mot d’ordre : protester contre l’éventuelle candidature du capitaine Moussa Dadis Camara à la future élection présidentielle, prévue au début de l’année 2010.
Présent sur place, l’ancien Premier ministre Sidya Touré, président de l’Union des forces républicaines (UFR), témoignera de la violence des militaires : « C’est une boucherie. Les bérets rouges étaient venus avec la volonté de tuer, nous, les hommes politiques et bien sûr un grand nombre de manifestants. C’est sans précédent. »
La répression sanglante va faire plus de 157 morts, 89 disparus, 1 500 blessés, sans parler de nombreux crimes sexuels.
Sur les antennes de Radio France Internationale (RFI), le capitaine Moussa Dadis Camara évoque alors un simple « accrochage », une « bousculade ». « On m’a dit que des gens ont tiré, mais je n’étais pas sur le terrain. (…) J’attends les statistiques. Qui a tiré ? Combien de blessés et de morts ? C’est dramatique, je suis désolé, très désolé », explique le putschiste.
Le lendemain, le président de la transition accuse les forces vives de Guinée d’être responsables de la tuerie.
« Ce n’est pas la première fois que cela arrive en Guinée, ce sont les mêmes leaders qui ont poussé à la boucherie en 2007. Ils distribuent de l’argent aux enfants pour les pousser à la révolte. Ce qu’ils ont fait lundi était prémédité. »
Aujourd’hui, l’homme comparaît devant ses juges en compagnie d’autres co-inculpés de ce massacre.
Face à la cour criminelle de Dixinn, sa réponse est toujours la même : « Je ne me vois pas coupable devant cet auguste tribunal. Je me dis que je ne suis pas coupable, et je n’ai aucune responsabilité pénale. »
Entre le génocide indonésien de 1965-1967 et la tuerie de Conakry en 2009, quel rapport ? Une même violence indicible des militaires et l’absence totale de regret vis-à-vis des actes commis.
Pourtant, les victimes et leurs familles méritent mieux que cela.
Il n’est jamais trop tard pour des procédures équitables, efficaces et publiques afin de rendre justice.
Eric Bazin
Le Lab pour Opinion Internationale